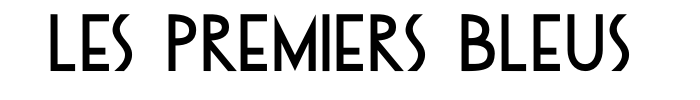Si mes premiers émois de supporters ont été provoqués par les Verts de la grande époque au milieu des années 70, l’équipe de France est à part pour moi.
Parce qu’elle n’est pas le jouet d’un président mégalomane (et le foot français en a connu des dizaines, de Roger Rocher à Jean-Michel Aulas en passant par Francis Borelli, Bernard Tapie ou Louis Nicollin).
Parce qu’elle est épargnée par la période des transferts l’été et celle du mercato l’hiver.
Parce qu’elle sait se faire rare (même si c’est moins le cas depuis une quinzaine d’années).
Parce qu’elle offre le plaisir pervers et étrange à tout supporter de se prendre pour un sélectionneur.
Parce qu’elle contraint le titulaire de ce poste à l’humilité et lui fait payer cher toute entorse à ce principe.
Parce qu’elle porte un maillot vierge de publicité, même s’il n’est parfois pas épargné par les outrances esthétiques.
Parce qu’elle est dépositaire d’une certaine idée du jeu, tourné vers l’attaque et la prise de risques, comme en 1958, comme en 1978, comme en 1982 et 1984, comme en 2000.
Parce que ses trois plus grands joueurs (Platini, Zidane, Kopa) sont des enfants de l’immigration (italienne, algérienne, polonaise).
Parce que, comme le service public, elle n’appartient à personne et donc appartient à tout le monde.
Voilà pourquoi malgré le trou noir des années soixante (que je n’ai pas connu même si j’étais déjà né), le passage à vide de la fin des années quatre-vingt (le nul à Chypre, la suspension de Cantona), le naufrage de quatre-vingt-treize, l’ennui mortel des deux premières années de l’ère Jacquet, la suffisance de la coupe du monde coréenne et la débâcle des deux dernières années Domenech, je continue à suivre cette équipe qui ne fait que renaître après avoir succombé.