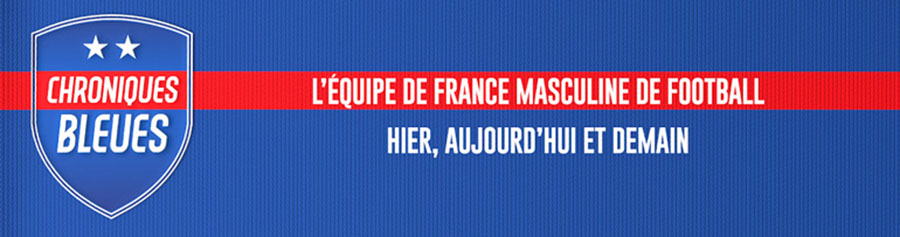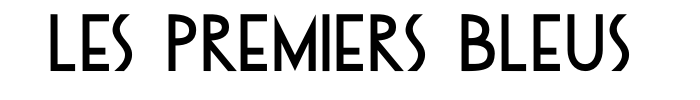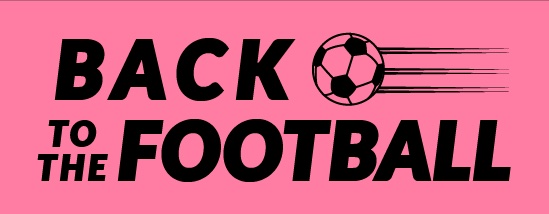Derrière son titre un peu tapageur, le livre « Football entre passion et business, le cocktail explosif ! » paru aux éditions Bréal/Studyrama en février 2025 fait l’inventaire des dangers qui menacent le football d’aujourd’hui, notamment sa financiarisation excessive.
Le football à la recherche de son identité
Daniel Ollivier, son auteur, y décrit l’appropriation des clubs par des entités économiques qui se soucient moins de la progression sportive que du profit qu’elles peuvent tirer de leur investissement. L’image du notable de province qui exerce la présidence du club avec autant de passion que de mégalomanie est aujourd’hui révolue. Elle laisse place à des conseils d’administration qui doivent rendre des comptes à d’obscures holdings transnationales.
Selon l’auteur, cette tendance provoque une dépersonnalisation du club, éloignant celui-ci de son ancrage territorial et de ses supporters. Ce constat l’incite à se replonger dans l’histoire du jeu afin de définir ce qui a fait la force du football et ce qu’il représente aux yeux de la population. En un mot, son identité, ou plutôt ses identités puisqu’il en a défini quatre : l’identité culturelle, l’identité nationale, l’identité juridique et l’identité d’appartenance.
Pour définir l’identité d’un club, l’auteur s’appuie sur son histoire, sur les conditions dans lesquelles il a été créé et celles qui lui ont permit de prospérer et de se professionnaliser. Il recherche quelles populations composent son public, mais aussi ce qui a fait la réputation du club : sa politique de recrutement, son système de formation, son rapport à la ville ou la région dans laquelle il évolue, les hommes qui lui ont permis d’atteindre l’excellence (joueurs, entraîneurs, managers, dirigeants…) et de durer dans le temps, le jeu traditionnellement pratiqué, les échecs qui lui ont permis de se remettre en cause, etc.
Pour construire son ouvrage, l’auteur a questionné quelques spécialistes témoins de ce qu’est devenu le football, notamment Christian Bromberger, Paul Dietschy, Pierre-Louis Basse, Pascal Blanchard, Albrecht Sonntag, Nasser Larguet, Jean-Baptiste Guégan, Wladimir Andreff, Jérôme Latta, Nicolas Hourcade, Anthony Thiodet et Thibault Leplat.
Quels périls pour le football de sélections ?
Le questionnement de Daniel Ollivier concerne également le football de sélection nationale. Si les fédérations n’ont pas encore fait l’objet d’OPA de grands groupes financiers, les équipes qui représentent des pays ne sont pas à l’abri des dérives observées en club. La notion d’identité y est tout aussi présente, exacerbée parfois au point de rejoindre quelques réflexes nationalistes.
Tout comme les compétitions de clubs, la Coupe du monde et les grandes épreuves continentales (Euro, Copa America, CAN…) subissent une volonté de leurs dirigeants de les transformer en un spectacle purement commercial, avec l’idée d’inonder les écrans, tout en flattant le patriotisme des consommateurs.
Si le triomphe d’une équipe nationale échappe rarement à l’instrumentalisation politique, le football reste un puissant moyen de reconnaissance pour des pays qui peinent à se faire une place sur l’échiquier géopolitique. Daniel Ollivier évoque également les mouvements populaires qui s’emparent du ballon rond pour donner de la résonance à leurs revendications. On ne peut nier toutefois que le sport le plus populaire de la planète est également utilisé de nos jours pour alimenter le soft power de gouvernements en mal de légitimité.
Daniel Ollivier, sociologue, a œuvré à la Direction technique nationale aux côtés du regretté Gérard Houllier. Le football est autant pour lui une passion qu’un domaine révélateur de l’état du monde. Il reste envers et contre tout supporter du FC Nantes et préside un collectif de passionnés, La Maison Jaune. Après avoir publié nombre d’ouvrages sur la sociologie, il consacre aujourd’hui sa littérature au football et justement à son identité. Après “L’alchimie du jeu à la Nantaise” (Solar 2022) et “Jean Vincent la passion du football” (Eric Jamet 2024), son nouvel ouvrage propose une vision plus générale du football et de ses tourments.
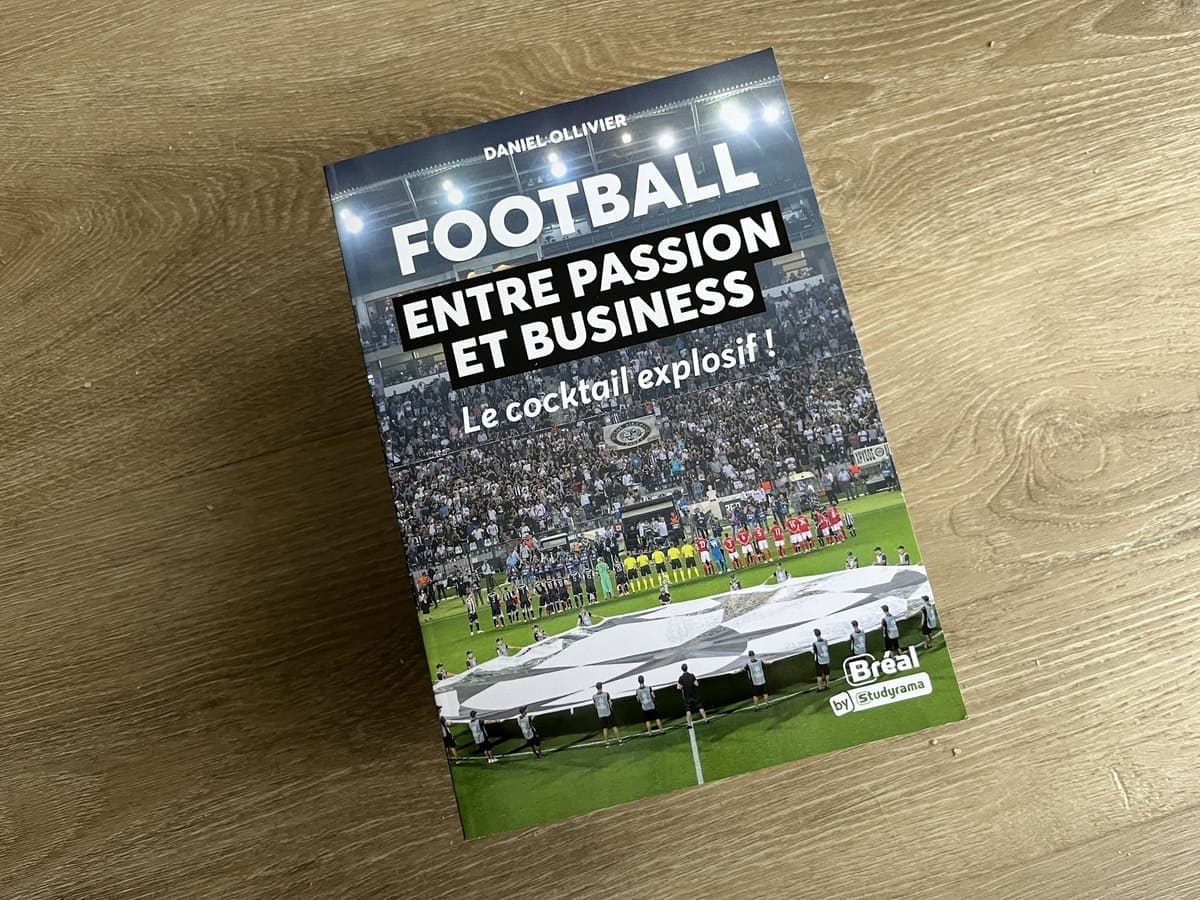
Les sélections nationales se sont imposées très tôt dans l’histoire du football. L’équipe de France a été créée dès 1904. L’Angleterre et l’Ecosse s’affrontent depuis 1872. Les équipes d’Autriche, de Hongrie, de Belgique existent depuis le début du XXe siècle. Est-ce le climat politique de l’époque qui a favorisé cette création ?
Il est intéressant de voir le rôle que joue notre pays dans l’émergence du football international à travers notamment la création de la Fédération Internationale du Football Association (FIFA) en 1904. Robert Guérin va en être le premier président, puis Jules Rimet va assumer cette responsabilité de 1921 à 1954. Il est à l’origine de la création de la première Coupe du Monde qui a lieu en 1930. Henry Delaunay marque aussi l’histoire de ce sport en créant la première compétition européenne des nations. Les journalistes Gabriel Hanot et Jacques Ferran sont à l’origine des Coupes d’Europe de clubs et du Ballon d’Or. Pour en revenir au début de siècle, celui-ci est marqué par une forte instabilité politique, avec de nombreux conflits et tensions entre les nations, en particulier en Europe. Les fondateurs de la FIFA, avec un certain succès, ont fait le choix de l’apolitisme et d’une organisation capable de rapprocher les peuples hors de toute influence politique ou idéologique.
« Certaines nations sont nées sur les terrains de football »
Les tournois olympiques des années 1920 puis la Coupe du monde créée en 1930 a permis de confronter différents styles de jeu. Ces épreuves ont-elles contribué à forger l’identité footballistique du pays, et par ce biais, un sentiment national ?
Dès son origine, le football international prend rapidement de l’ampleur. Il est certain que les styles de jeu étaient très différents d’un pays à l’autre. Les vertus d’une nation étaient censées s’exprimer à travers sa manière de jouer au football. C’est le génie créatif des Brésiliens face à la rigueur germanique. Certaines nations sont nées sur les terrains de football et pas sur les champs de bataille. C’est le cas notamment de l’Italie. Mussolini n’était pas un adepte du football mais il comprend très vite le profit qu’il peut escompter de l’organisation de la Coupe du Monde en 1934. Ce qui n’était qu’un royaume va devenir, grâce au football, une nation fière de son équipe nationale.
Dès lors, peut-on vraiment considérer que le football est apolitique alors qu’il est manipulé par les politiciens de tout bord ?
L’histoire montre qu’il n’est pas facile d’instrumentaliser le football. Les dirigeants de certains pays totalitaires tels que Hitler ou Videla en Argentine ont tenté de le faire sans y parvenir. A l’inverse, le football va servir d’étendard à des revendications populaires comme c’est le cas en Iran ou en Turquie. La FIFA parvient à garder son autonomie mais elle va se montrer, dès les années 80, avec Joaõ Havelange perméable aux influences économiques des multinationales telles que Adidas. Le choix du Qatar pour organiser la Coupe du Monde montre que nous sommes dorénavant dans une autre logique.
« La multiplication des compétitions internationales montre bien que l’on entre dans une nouvelle ère »
Ton livre explique que la course au profit dénature le football au risque de lui faire perdre sa raison d’être. Le football de sélections, où la notion de transfert n’existe pas, représente-t-il une forme de résistance face au foot-business ?
Le football des nations permet, dans un monde atomisé où la mondialisation supprime les frontières, de redonner du sens au sentiment national. La Coupe du Monde en 1998 a été en France un vibrant exemple de ce besoin de se retrouver ensemble malgré nos différences. Les compétitions internationales restent la survivance d’un football qui s’inscrit dans l’histoire et qui se perpétue à travers le temps. Ce qui en faisait son originalité était aussi sa rareté. La multiplication des compétitions internationales montre bien que l’on entre dans une nouvelle ère dans laquelle le business trouve pleinement sa place.
L’incessante augmentation du nombre d’équipes en phases finale des grands tournois (Coupes du monde, Euro, CAN, etc.) donne de la visibilité à certains pays, mais est-elle synonyme de progression pour l’épreuve en elle-même ?
Il serait trop simple d’imaginer que le but recherché est d’accroître le niveau de performance sportive. Gianni Infantino, le président de la FIFA, se ménage sa réélection en augmentant le nombre de pays invités à la phase finale de la prochaine Coupe du Monde. Cette institution est en concurrence avec l’UEFA mais aussi avec les grands clubs européens qui souhaitent créer leur propre compétition en ligue fermée. D’où la création de la Coupe du monde des clubs que nous allons découvrir en juin prochain. Évidemment. Le business n’est pas étranger à une telle décision.
Les caractéristiques des équipes nationales semblent s’effacer au fil du temps. La concentration des meilleurs joueurs dans trois ou quatre championnats n’a-t-elle pas contribué à une uniformisation du football ?
Nous sommes en effet loin du match du siècle en 1953 où les Hongrois à Wembley écrasent les Britanniques par 6 buts à 3. La victoire tactique contre la puissance athlétique incarnait à l’époque cette diversité culturelle dans la manière de concevoir le football. Aujourd’hui, tout se joue sur le talent individuel des stars. La concentration des meilleurs joueurs est favorisée par les naturalisations. Le paradoxe, c’est lorsque l’on retrouve deux frères qui s’affrontent lors d’un match de Coupe du Monde. C’était le cas de Jérôme Boateng qui joue pour l’Allemagne contre son pays le Ghana et son frère Kevin-Prince Boateng.
« Notre pays représente avec le Brésil le gisement le plus productif de joueurs professionnels »
Existe-t-il selon toi une identité de jeu à la française ? Est-elle plus proche du romantisme des années 1980 ou du pragmatisme des années 1998-2018 ?
Le football français s’inscrit dans la même évolution que celle des autres pays. L’approche du jeu de Didier Deschamps ou d’Aimé Jacquet n’a pas grand-chose à voir avec celle de Hidalgo ou de Batteux. La qualité de la formation en France est souvent mise en évidence et pour cause puisque notre pays représente avec le Brésil le gisement le plus productif de joueurs professionnels. Mais à l’inverse des Espagnols et des Portugais, nous ne défendons pas un style de jeu particulier. Notre manière de former privilégie la capacité à s’adapter à tous les styles.
Les joueurs de l’équipe de France ont-ils un devoir de représentation de leurs concitoyens ?
Je pense que l’exigence qui concerne chaque joueur professionnel l’est encore un peu plus pour ceux qui portent la tunique tricolore. Le sport est porteur de valeurs et l’exemplarité s’impose. Cette question a fait débat dans notre pays autour de l’hymne et le fait de savoir si les joueurs avaient l’obligation ou pas de chanter la Marseillaise.
Ce “débat” remonte en effet régulièrement depuis le milieu des années 1990. On oublie trop souvent que les joueurs représentent avant tout une fédération et non pas à proprement parler un pays…
En effet. Il est d’ailleurs intéressant de rappeler qu’au-delà de son équipe nationale, notre pays dispose de deux autres équipes affiliées à la FIFA, à savoir Tahiti depuis 1990 et la Nouvelle Calédonie en 2004. Elles sont engagées dans les compétitions internationales de la confédération océanienne. Ce cas de figure n’est pas très connu et il est plutôt rassurant de constater qu’il ne fait pas l’objet de polémique.