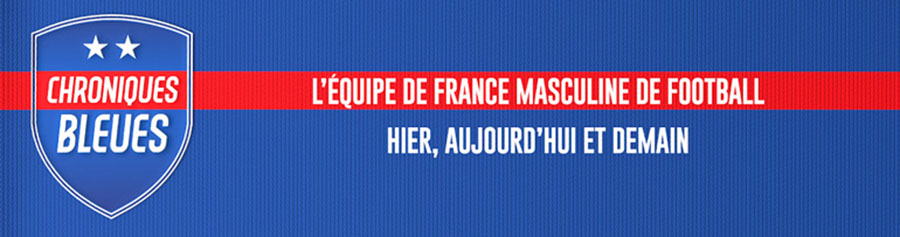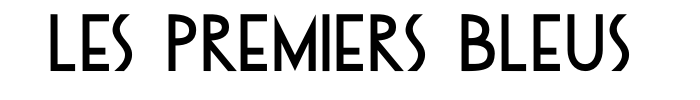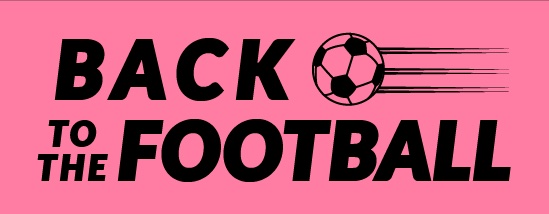Hormis un titre de champion acquis en 1950 un peu à la surprise générale parce qu’ils étaient promus - seuls Saint-Étienne en 1964 et Monaco en 1978 ont réussi pareil exploit - les Girondins ont surtout marqué l’histoire du football français sous la présidence de Claude Bez (1978-1991), architecte du grand Bordeaux titré trois fois (1984, 1985, 1987), double vainqueur de la Coupe de France (1986, 1987) et double demi-finaliste européen (C1 en 1985, C2 en 1987).
Quand Claude Bez recrute en Bleu
Quand le dirigeant à la moustache et à la Cadillac a pris en main les Girondins, ces derniers vivotaient dans le ventre mou de la D1 avec comme principale étoile le lutin (1,62 m) et héros local Alain Giresse (47 sélections, la première en 1974), mais aussi des joueurs de la région comme le futur pharmacien Francis Meynieu (1 sélection en 1976), Jean-François Domergue (9 sélections, héros de la demi-finale de l’Euro 1984 contre le Portugal), Jean-Marc Furlan (France A’), Jean-Marc Ferratge (1 sélection), les frères Gallice, Jean (7 sélections) et André (Espoirs), ainsi que le gardien basque Philippe Bergeroo (3 sélections).
Comptable de profession ambitieux, Bez leur adjoint au fil de ses premières saisons à la tête du club des valeurs sûres, généralement en fin de contrat dans leurs clubs respectifs. Ainsi débarquent des joueurs bien installés en Bleus comme Marius Trésor (65 sélections), Bernard Lacombe (38) ou Patrick Battiston (56) ou déjà aperçues en sélection comme Gérard Soler (16), Albert Gemmrich (5), Omar Sahnoun (6), François Bracci (18), Léonard Specht (18) et Thierry Tusseau (22), des joueurs à fort potentiel comme Jean Tigana (52) ou internationaux en devenir comme René Girard (7) ou Jean-Christophe Thouvenel (4).
Michel Hidalgo est aux premières loges
Le sélectionneur français Michel Hidalgo, qui vit alors à Saint-Savin-de-Blaye en Gironde, est un habitué du Parc Lescure. Il assiste ainsi à la montée en puissance des joueurs au scapulaire, qualifiés européens de 1981 à 1989 sans interruption, et goûte aux performances des internationaux tricolores.
En quête d’un arrière droit pour le Mundial espagnol, Hidalgo ira même jusqu’à sonder Gernot Rohr, débarqué d’Allemagne de l’Ouest durant l’été 1977 alors que Bez n’est encore que trésorier des Girondins. En vain car à cette époque, quand on a joué en juniors pour une sélection (avec Manfred Kaltz, Uli Stielike, Uli Hoeness, Paul Breitner notamment) comme c’est le cas de Rohr, on ne peut pas être sélectionnable pour un autre pays. « Ca m’aurait beaucoup intéressé », dira d’ailleurs et sans regret après sa carrière Rohr, le plus francophile des Allemands, véritable légende des Girondins (436 matches disputés, 66 matches dirigés comme entraîneur).
Six Bordelais en Espagne en 1982
Si aucun Girondin ne figure dans le groupe tricolore qui dispute la Coupe du monde en Argentine - à cette époque, beaucoup estiment que Giresse, qui va sur ses 26 ans, et l’étoile montante stéphanoise Michel Platini, bientôt 23 ans, ne peuvent évoluer ensemble - Hidalgo en retiendra six pour l’édition suivante en Espagne (Trésor, Girard, Giresse, Tigana, Lacombe, Soler) puis cinq pour l’Euro 1984 en France (Battiston, Tusseau, Tigana, Giresse, Lacombe).
Sur les 22 joueurs retenus par Henri Michel, le successeur de Hidalgo, pour le Mondial mexicain en 1986, onze auront, au cours de leur carrière, porté un jour les couleurs des Girondins.
Giresse, petite taille, grand talent
L’influence bordelaise chez les Bleus va aller grandissante dans les années 80. Si la mémoire collective française se souvient de Séville, des buts de Trésor et Giresse (2e du Ballon d’Or 1982 derrière l’Italien champion du monde Paolo Rossi) en prolongation contre la RFA, de l’abattage de la révélation Tigana ou de l’agression violente de Harald Schumacher sur Battiston, on doit rappeler que le premier but tricolore en Espagne est 100 % girondin avec un but inscrit par Soler servi en profondeur par Giresse contre l’Angleterre (1-3).
Le match suivant face au Koweït (4-1) est entré dans l’histoire suite à la descente sur le terrain du Cheikh Fahid Al-Ahmad Al-Sabah, frère de l’Émir de cet État, qui fait annuler un but de Giresse - auteur de la passe décisive au préalable sur celui de Platini - après un coup de sifflet entendu dans les tribunes du stade de Valladolid. Pour le match décisif pour la qualification face aux Tchécoslovaques (1-1), Lacombe sera prépondérant sur l’ouverture du score de Didier Six.
Au second tour, Giresse sera la grand artisan du succès face à l’Irlande du Nord (4-1), envoyant les Bleus en demi-finale. D’abord en convertissant en but un super débordement de Platini, puis en servant Dominique Rocheteau pour le doublé de ce dernier, lui aussi dans un grand jour, et enfin en clôturant la marque de la tête après un une-deux avec Tigana. Deux jours à peine après l’irrespirable soirée sévillane, les Français ont conclu leur épopée espagnole à la 4e place, battus par la Pologne (2-3) malgré l’ouverture du score de René Girard, alerté par Tigana, encore à l’origine du but d’Alain Couriol après la pause.
Platini snobé
Le point d’orgue de la présence girondine en équipe de France date toutefois de l’Euro 1984. Un peu trop d’ailleurs pour Michel Platini, héros de la compétition avec ses 9 buts en 5 matchs, qui le dénoncera d’ailleurs lors de la mi-temps du match inaugural face au Danemark (1-0) en poussant une gueulante dans le vestiaire, reprochant aux Bordelais, tout frais champions de France avec des automatismes acquis et des connexions bien huilées, de jouer entre eux.
Après re-visionnage partiel du match, on peut entendre la position du meneur turinois, parfois oublié, voire snobé, par ses partenaires bordelais, même après son courroux de la pause. A la 75e minute par exemple, sur une passe en profondeur de Battiston habilement feintée par Tigana qui met dans le vent deux Danois, le ballon parvient à Giresse qui choisit d’y aller seul et tire de peu à côté plutôt que de servir son capitaine pas très loin. En revanche, sur l’ouverture du score de Platini quatre minutes plus tard, on ne peut reprocher aux Bordelais de l’avoir joué entre eux.
Après une récupération haute de Tigana d’un ballon perdu au duel par... Platini, Giresse est servi et opte pour Lacombe pris dans un étau par deux Danois alors qu’il y a aussi l’option Bruno Bellone esseulé sur son aile gauche. Sur cette action, Platini est derrière le champ de vision de Giresse donc difficilement touchable. La passe de ce dernier vers Lacombe est repoussée par la défense des Vikings et revient dans la course d’élan de Platini qui d’un tir du droit involontairement dévié par la tête de Søren Busk se trouvant au sol trompera le gardien Ole Qvist.
Les rushes de Tigana
Lors des matches suivants, tout rentrera dans l’ordre entre Platini et les Bordelais, présents sur quatre des cinq buts français contre la Belgique (5-0), sur le 2e but inscrit de la tête par Platini face à la Yougoslavie (3-2) avec une action où on retrouve Tigana puis Giresse et enfin Battiston pour le centre victorieux.
Face au Portugal en demi-finale à Marseille, c’est un ex-Girondin, Domergue, qui volera la vedette à Platini grâce à un doublé improbable dont un coup-franc direct - la réalisation TV, mal habituée, affichera à l’écran le nom de Platini après ce but. Et dans un dernier rush avec une double accélération, Tigana, qui n’a alors jamais gagné une séance de tirs au but, évitera un remake éventuel de Séville en servant Platini pour le but de la qualification (3-2 a.p.). Autre grand bonhomme de cette édition, Tigana (2e du ballon d’Or derrière Platini) sera encore à l’origine du but de la délivrance de Bellone en finale contre l’Espagne (2-0).
Le titre de champion de France 1985 vient valider le rayonnement d’alors des Bordelais, qui atteignent pour la première fois le dernier carré européen. En demi-finale de la Coupe des Clubs champions, ils retrouvent Platini et la Juventus, finaliste de la C1 en 1983, vainqueur de la C2 en 1984 et favorite pour cette édition.
Après avoir subi une leçon d’italien à l’aller à Turin (0-3), les joueurs d’Aimé Jacquet, quasiment tous internationaux - on dénombre 9 internationaux français (Dominique Dropsy et ses 17 sélections époque strasbourgeoise s’ajoute à huit cités précédemment), les internationaux allemand (Dieter Muller) et portugais (Fernando Chalana), seul Rohr ne l’a jamais été - sont tout proches au retour de renverser la Juve (2-0) qui remportera le trophée au Stade du Heysel de Bruxelles de triste mémoire face à Liverpool (1-0).
Derniers tours de piste
Cette génération bordelaise, orpheline de Trésor qui a pris sa retraite internationale avant l’Euro, puis de Lacombe juste après, sera encore sur le pont au Mexique après sa victoire en finale de la Coupe de France 1986 aux dépens de Marseille (2-1 a.p.) avec ce lob iconique de Giresse qui rejoindra... la Canebière et l’OM de Bernard Tapie deux mois plus tard. Un peu moins fringants avec deux années de plus au compteur, excepté le moteur Tigana, les joueurs girondins vont moins peser qu’en 1982 ou 1984. Giresse sera crédité d’une passe décisive contre l’URSS (1-1) à destination de Luis Fernandez et Tigana trouvera enfin la mire face à la Hongrie (3-0) à l’occasion de sa 41e sélection. Giresse, Tigana et Battiston seront titulaires contre l’Italie en huitième de finale (2-0), le Brésil en quart (1-1, 4-3 t.a.b.) et la RFA en demi-finale (0-2) - Tusseau entrera contre l’Italie et jouera les 120 minutes contre le Brésil - sans marquer ces matches de leur empreinte.
Pour rester aux avant-postes en D1, Bez décide à l’été 1986 d’oxygéner son effectif. Giresse parti, il confie les clés du jeu offensif à un trio déjà bien connu et coté du football français, pour certains annoncés comme des successeurs de la génération Platini. Présents au Mexique, l’Auxerrois Jean-Marc Ferreri (37 sélections) et le Lensois Philippe Vercruysse (12 sélections) se greffent très bien aux tauliers Tigana, Girard, Battiston et Specht ou au jeune formé au club Alain Roche (25 sélections), de même que le Nantais José Touré (16 sélections), référencé +artiste brésilien+ depuis la finale de Coupe de France 1983 face au Paris SG. Autre bonne pioche française venue de Suisse au mercato d’hiver, le quasi inconnu Philippe Fargeon qui inscrira 20 buts en 32 matches disputés lors de son premier exercice bordelais, ce qui lui ouvrira les portes de l’équipe de France (7 sélections).
Génération perdue
Auteur du seul et unique doublé de leur histoire en 1987, les Bordelais échoueront encore en demi-finale européenne, cette fois battus aux tirs au but de la Coupe des Coupes par le Lokomotiv Leipzig. Sur la scène internationale, l’après Platini sera moins florissant et le flambeau bien lourd à porter malgré le CV des anciens qui ont décidé de rester comme Joël Bats, Tigana, Fernandez, Battiston ou le plus jeune Manuel Amoros.
Les deux phases de qualifications suivantes pour l’Euro 1988 en RFA et la Coupe du monde 1990 en Italie seront des échecs retentissants et le début de la rentrée dans le rang pour les internationaux bordelais supplantés par d’autres talents venus de Marseille, Monaco ou Auxerre principalement.
Avant la descente administrative des Girondins en D2 pour problèmes financiers en 1991, cinq néo-Girondins, jamais titrés en marine et blanc, connaitront la joie de la sélection : Didier Sénac (3 sélections), Didier Deschamps (103 sélections dont 5 sous les couleurs bordelaises), Bernard Pardo (13 sélections), Jean-Philippe Durand (26 sélections) et Dominique Bijotat (8 sélections).
Sous l’ère Bez - qui a occupé le poste de superintendant de l’équipe de France à partir de 1988 et désigné Platini sélectionneur en novembre de la même année après le fiasco de Nicosie (1-1 à Chypre) - Bordeaux aura eu au total 21 joueurs sélectionnés en Bleu.