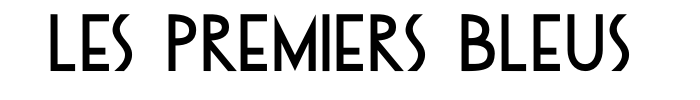Dans Ce que le football est devenu (éditions Divergences, 200 pages, 15 euros), Jérôme Latta, fondateur des Cahiers du football et journaliste indépendant (il écrit notamment pour Le Monde, Médiapart, Arrêt sur images ou Alternatives économiques) raconte trente ans de révolution libérale qui ont fait du foot non plus un sport populaire et accessible, mais un spectacle, un divertissement, une industrie, un outil de soft power et une fantastique machine à cash.
Quel est le point de départ de ce livre ? Est-il le seulement le prolongement de tes articles, ou y a-t-il eu un élément déclencheur ?
Depuis les débuts des Cahiers du football (1997), j’ai suivi très régulièrement les thèmes abordés dans ce livre, mais sous l’angle des faits d’actualité qui motivaient un article, c’est-à-dire de manière très fractionnée – même si j’ai toujours essayé de lier ces faits particuliers avec une évolution globale très cohérente. L’idée a justement été de recomposer un tableau général de ce que j’appelle la « révolution libérale » du football, pas pour faire une synthèse de mes articles, mais pour mettre en évidence le sens et les conséquences de tout ce qui a contribué à cette révolution. D’autant que c’est précisément une vision d’ensemble qui a manqué pour en prendre conscience et la mettre en débat.
En lisant les citations que tu as choisies, et notamment « créé par les pauvres, volé par les riches », on ne peut s’empêcher de penser à beaucoup d’autres domaines que le football. Ce dernier n’a-t-il pas, finalement, suivi la même pente que la santé, l’éducation, l’énergie et les transports ?
Il a en tout cas été l’objet d’un processus brutal de libéralisation, de dérégulation et de financiarisation – trois termes pour dire à peu près la même chose et décrire un mouvement d’accaparement des richesses. Pour autant, le football n’est pas un service public. Mais on devrait le considérer, à mon sens, comme un bien commun, un patrimoine collectif. La valeur symbolique et donc économique des clubs a été constituée au cours de leur histoire par une multitude d’acteurs, et ils ne devraient pas pouvoir appartenir à leurs seuls actionnaires – même si, juridiquement, c’est évidemment le cas, hélas. Il faut même souvent protéger ce patrimoine contre ces actionnaires.
« Les titres sont moins importants que l’appartenance à l’élite »
L’erreur tragique a été de considérer que les clubs de football étaient « des entreprises comme les autres » : ce sont certes des entreprises, mais pas comme les autres. Avec cette conception, faute de défendre une spécificité du sport, on a ouvert leur capital à toutes sortes d’investisseurs, et on a contribué à faire du football l’instrument de desseins qui lui sont totalement étrangers – au sens propre et surtout au sens figuré. Pour dire ça d’une formule, on voit à quel point, aujourd’hui, le football ne s’appartient plus.

Tu as souvent expliqué qu’en sport, et peut-être plus généralement dans la vie, il est plus courant d’échouer que de réussir. Or la transformation du football en spectacle, paradoxalement, ne supporte pas l’échec. Comment l’expliquer, si la finalité est de divertir en vendant (cher) un spectacle plutôt que d’essayer gagner des titres ?
La transformation du football en industrie a souligné l’incompatibilité entre la logique sportive et la logique économique, qui ne peut pas tolérer l’aléa sportif, et a donc cherché, avec succès, à le réduire en corrélant de plus en plus étroitement les résultats à la puissance financière. Pour la petite élite qui s’est ainsi constituée, les titres sont finalement moins importants que l’appartenance à cette élite. La nécessité première, pour ces clubs, a été de se qualifier en Ligue des champions, sans avoir besoin de remporter le titre national ni même de briller en Ligue des champions – au sens de la remporter, du moins.
Le principe qui s’est imposé, c’est celui du spectacle plutôt que de la compétition, qui devient presque secondaire : ce que « vend » la Super Ligue, c’est d’abord le show prestigieux, hollywoodien, de ces superclubs alignant des superjoueurs. Ensuite, c’est-à-dire actuellement dans l’entre-soi des tours finaux de la Ligue des champions, ou un jour dans celui d’une ligue privée et fermée, l’incertitude sportive peut-être rétablie puisque le risque économique a été éliminé. Et malgré tout, les trophées conservent leur prestige.
L’offensive de l’Arabie Saoudite sur le football européen cette été, qui ressemble quasiment à une OPA, n’est-elle pas l’aboutissement logique de cette révolution libérale que tu documentes ? A force de s’adresser à une audience mondiale et à se détacher de ses territoires, le foot européen ne prend-il pas le risque de se faire déborder par plus riche que lui ?
Autant le rachat de clubs européens par des fonds souverains résulte directement des possibilités offertes par la financiarisation, autant la campagne saoudienne de recrutement massif de stars pas toutes en préretraite, et surtout de joueurs au pic de leur carrière, voire de jeunes joueurs très prometteurs, procède d’un pari qui a été, je pense, directement inspiré de la réussite diplomatique de la Coupe du monde au Qatar. Celle-ci a démontré que le monde du football était largement indifférent à la question des droits humains et à celle de l’environnement, mais aussi que ce monde du football était déjà devenu multipolaire.
« Mettre en marge l’Europe et de s’adresser aux nouvelles audiences »
Avec l’aval de la FIFA, qui partage les mêmes intérêts, l’objectif est de mettre en marge l’Europe (donc implicitement l’Occident), et de s’adresser aux nouvelles audiences créées par l’expansion du football hors de ses continents historiques – Europe et Amérique latine. Un championnat all-stars, même créé de toutes pièces, peut séduire ces audiences, surtout si elles épousent le rejet de la domination occidentale.
Cela étant, on peut douter de la pérennité de ce projet, dans la mesure où son manque de légitimité historique est tout de même pénalisant, et où l’engouement très intéressé des joueurs ne durera peut-être pas très longtemps. Il faut aussi rappeler que l’exode vers la Saudi Pro League ne concerne en définitive qu’une petite fraction de joueurs.
Dans quelle mesure les sélections nationales échappent-elles à l’élitisme extrême du football de clubs ? Les compétitions auxquelles elles participent semblent plus ouvertes, comme on l’a vu au Qatar avec le Maroc, en Russie avec la Croatie, ou à l’Euro avec le Danemark…
Oui, et les grandes nations ont de grands moments de faiblesse, ou peinent à être régulières, hormis la France. Les résultats deviennent plus erratiques, comme ceux de l’Italie, qui cale une victoire à l’Euro entre deux non-qualifications à la Coupe du monde. C’est le paradoxe de l’affaiblissement du football de sélections face à l’hégémonie du football de clubs : il a conduit à un nivellement des valeurs et à un retour d’incertitude. Sans être trop candide, les grands tournois finaux gardent une forme de pureté, une séduction particulière indépendamment du niveau de jeu proposé. Enfin, ça, c’était avant la Coupe du monde 2022 et le passage à 48 équipes pour l’édition 2026.
En quoi les sélections pâtissent-elles de l’hypertrophie financière des clubs et de leurs exigences ? Le niveau général des sélections, y compris des plus grandes (Brésil, Allemagne, Italie, Argentine) a-t-il baissé depuis 30 ans ?
Les sélectionneurs des grandes nations sont rarement des « top entraîneurs », qui sont bien mieux payés dans les clubs. Ils doivent gérer des internationaux sursollicités par leurs (grands) clubs, des temps de préparation réduits, les conflits d’ego, plus tout le Barnum fédéral. Bien préparées, surmotivées, plus fraîches, les « petites » sélections font plus souvent la surprise. Mais elles ont le même problème que les outsiders dans les coupes d’Europe : leurs aventures ne vont jamais jusqu’au bout, et elles sont souvent sans lendemains. Les grandes nations et les grands clubs continuent de truster les palmarès.
« On en demande peut-être plus aux sélections »
Est-ce juste de constater que les sélections sont plus exposées sur des questions sociétales (racisme, violences sexistes et sexuelles, discriminations, nationalisme) que les clubs, qui sont pourtant très loin d’être exemplaires dans ces domaines ?
On en demande peut-être plus aux sélections, dans cette manière de leur faire incarner des symboles et des « valeurs » qui les dépassent complètement, comme cela a été particulièrement le cas en France. Mais les rapports avec la sélection nationale sont très différents d’un pays à un autre. Et de leur côté, en devenant des « marques internationales », les clubs sont eux aussi très surveillés et sollicités.
« Il faut une marque, un trophée, un logo… occuper le plus de créneaux possibles »
Ce n’est pas suffisant pour leur faire renoncer à leurs très nombreuses pratiques moralement répréhensibles, mais cela crée une exigence. On assiste à un mouvement global de repolitisation du sport et des sportifs, qu’il faut nuancer, mais le fait est que les stades ne sont plus étanches aux mobilisations dites sociétales, notamment. Le mythe de l’apolitisme du sport a fini de voler en éclats ces dernières années, et tant mieux.
"Ce que le football est devenu" sort aujourd'hui. Comme c'est le sommet de ma non-carrière dans la presse sportive et le résultat de 25 ans d'écriture sur ces sujets, je vous invite à le lire : ça ne m'enrichira pas énormément, mais ça me fera plaisir ! https://t.co/m4oE7im1MO
— Jérôme Latta (@jeromelatta) October 6, 2023
La quasi disparition des matchs amicaux internationaux, qui ont pourtant structuré la vie des sélections jusqu’au milieu du siècle dernier mais jugés non rentables, et leur remplacement par des compétitions de seconde zone comme la Ligue des Nations, procède-t-elle de la même course au profit que celle des clubs ?
Il y a une guerre des calendriers, une guerre de tous contre tous : clubs, sélections, ligues, fédérations, UEFA, FIFA. Il faut occuper le plus de créneaux possibles, générer le plus de droits de diffusion, ce qui alimente la tendance à hypertrophier les compétitions existantes et à en inventer d’autres pour créer de l’enjeu. Il faut une marque, un trophée, un logo… Avec des formules baroques comme celles de la Ligue des nations ou de la future Ligue des champions. L’idée est aussi de proposer des grosses affiches, quitte à les banaliser et à saturer un peu plus l’offre médiatique. Au moins, on ne jouera plus contre des gueux barricadés devant leur but.
La Ligue des Nations propose deux tendances a priori contraires : le retour à une compétition de format resserré comme l’était le championnat d’Europe jusqu’en 1976, mais aussi l’introduction de strates hiérarchiques dans les phases de qualification.
Oui, clubs ou sélections, il y a une tendance de fond à hiérarchiser les compétitions, comme les trois coupes d’Europe actuelles qui forment des divisions, avec des systèmes de championnat. Ça ressemble quand même moins à une pyramide qu’à des étages bien cloisonnés. D’une manière générale, par exemple avec le moindre nombre de relégations et l’instauration de barrages dans les championnats nationaux, on cherche à « sécuriser » les positions, donc à les figer.
« la FIFA gouvernée par Gianni Infantino, c’est encore un autre niveau de cynisme »
Cela s’observe aussi à un niveau plus transversal : le fonctionnement du marché des transferts, dans un contexte d’inégalités économiques croissantes, a contribué à assigner les clubs à leur fonction sur ce marché. Très schématiquement : en bas les clubs formateurs, au milieu les clubs valorisateurs et en haut, les clubs acheteurs – les seuls vrais gagnants.
Le risque d’une Coupe du monde à deux vitesses, avec plus de la moitié des nations qualifiées d’office (comme au rugby) est-il réel, ou l’hypertrophie constatée depuis 1998 est-elle un signe d’ouverture ?
Une Coupe du monde à deux vitesses me semble peu probable. De plus en plus de pays pratiquent le football et le développent, alors on ira probablement vers plus de compétitivité, même si les écarts avec les derniers de la classe risquent de se creuser. 48 équipes, ça a pour effet de délayer l’intensité d’une Coupe du monde, et de la dévaloriser un peu.
L’argument « Ça permet de développer le football dans ces pays » peut s’entendre, mais il semble un peu incertain. En revanche, « Ça permet d’augmenter nos revenus », c’est une certitude. Idem pour « Ça me rapporte des voix. » La FIFA a toujours été la FIFA, mais la FIFA gouvernée par Gianni Infantino, c’est encore un autre niveau de cynisme.
La Coupe du monde 2030 devrait être attribuée à six pays sur trois continents, achevant par l’absurde l’éparpillement et le gigantisme de la compétition. Qu’est-ce qu’on peut dire de ce choix, alors que l’Arabie Saoudite vient d’annoncer sa candidature pour 2034 ?
Gianni Infantino et la FIFA semblent lancés dans une fuite en avant sans fin, affichant un mélange d’électoralisme et de mépris pour l’environnement, les droits humains et les supporters. À 48 équipes, la Coupe du monde devient inorganisable, implique des coûts économiques et environnementaux insoutenables. La coorganisation Espagne-Portugal-Maroc faisait encore sens et limitait relativement les impacts, mais il a fallu donner un lot de consolation à l’Uruguay, au Paraguay et à l’Argentine – au lieu de leur confier l’organisation d’un Mondial.
L’attribution des éditions 2018 à la Russie et 2022 au Qatar, dans les conditions de corruption que l’on sait, aurait dû favoriser une prise de conscience. Elle semble au contraire avoir ouvert un « cycle du pire » : après l’édition 2026 dans trois (immenses) pays, 2030 sur trois continents, et la voie ouverte pour l’Arabie saoudite en 2034. La FIFA prostitue le football et sa plus belle compétition. À un moment, il ne faudra plus se contenter de soupirer.