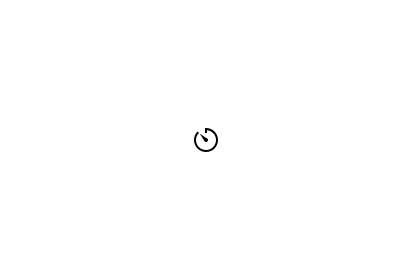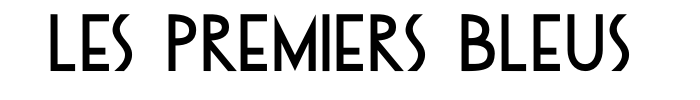Il tient une chronique dans L’Equipe avant et après chaque match des Bleus, ainsi qu’un club Liza spécial équipe de France sur RTL et bien sûr, il commente tous les matchs de la sélection depuis 2010 sur TF1.
Il est surtout l’un des trois internationaux avec Robert Pirès et Marcel Desailly à avoir tout gagné entre 1998 et 2003 (Coupe du monde, Euro, deux Coupes des confédérations). C’est enfin l’un des plus grands arrières gauches de l’histoire du football français dans la lignée de Roger Marche ou Max Bossis, l’un des quatre du carré magique défensif (et invaincu) de 1996-2000.
Bixente Lizarazu, premier champion du monde à s’exprimer sur Chroniques bleues !
Le 15 juillet 2018, vous avez commenté en direct la finale de la Coupe du monde à Moscou. Qu’est-ce qui domine dans ces moments-là ? L’émotion de revivre des événements pareils vingt ans plus tard ? La frustration de ne pas être sur le terrain ? Le stress de parler à près de 26 millions de téléspectateurs ?
Je ne me suis pas du tout positionné par rapport à vingt ans avant. Je suis passé à autre chose, je fais un autre métier. J’avais le sentiment qu’on vivait une très belle Coupe du monde 2018, et j’avais envie de bien faire les choses jusqu’au bout. Avec le même état d’esprit que quand tu es joueur : la finale, tu veux la gagner pour marquer l’aventure, il ne faut pas la rater. L’idée c’était de répondre présent dans le commentaire et de bien faire le boulot jusqu’à la fin.
« Tu es la voix de l’équipe de France 2018 qui gagne la Coupe du monde »
Après, j’avais conscience aussi d’être le commentateur de la finale de la Coupe du monde où la France joue, ça reste le Graal dans le métier : beaucoup de journalistes ou de consultants auraient aimé le faire. C’était ça les sentiments que je ressentais. Tu es la voix de l’équipe de France 2018 qui gagne la Coupe du monde. Mais joueur et commentateur, ça n’a rien à voir.
Avec Grégoire Margotton, vous formez depuis 3 ans un duo très complémentaire et complice. Ambitionnez-vous d’être les successeurs du duo Roland-Larqué ?
On n’y pense même pas, je ne vais pas parler à la place de Grégoire. On fait notre taf, à notre façon, comme on le ressent. On pense simplement au plaisir que l’on a à commenter ensemble, à vivre de belles aventures, sans savoir combien de temps ça va durer. Le paysage audiovisuel d’aujourd’hui, découpé et splité dans tous les sens, n’a absolument rien à voir avec l’époque de Larqué et Roland où il n’y avait que quelques chaînes. Ce qui m’anime c’est de vivre de belles aventures. Celle-là était très belle parce que la France a gagné, mais j’ai adoré les Coupes du monde au Brésil ou en Afrique du Sud. Ce qu’on a vécu en Russie avec Grégoire, c’est la découverte d’un pays que je ne connaissais pas.
Vous tenez une chronique régulière dans L’Equipe depuis 2006 dans laquelle vous vous appuyez beaucoup sur votre vécu pour éclairer les enjeux et les choix auxquels sont confrontés les joueurs et le sélectionneur. En quoi le ton est-il différent de celui que vous avez à la télé ou à la radio ?
C’est difficile à juger pour moi, mais ce n’est pas le même exercice. Pour la chronique, je choisis un angle, un détail. Je décide de parler d’un joueur ou d’une question tactique. C’est rare de faire un papier général, je vais plutôt rentrer dans le détail. Soit c’est moi qui le définit, soit c’est la rédaction en fonction des autres articles du journal. Mais à chaque fois j’ai une liberté totale sur ce que je raconte, à condition qu’il y ait une cohésion avec la ligne éditoriale.
Ma chronique de L’Equipe, je ne la fais pas le soir même du match, mais le lendemain, et elle est publiée le jour d’après. Les soirs de match, je commente jusqu’à 22h45 à la télé, après je suis à l’antenne de RTL jusqu’à minuit. Donc impossible d’écrire une chronique dans ce laps de temps.
Est-il difficile de commenter les choix et la gestion d’équipe de Didier Deschamps, avec qui vous avez partagé près de huit ans de carrière internationale ?
Je me sens complètement à l’aise, d’autant que j’ai une relation privilégiée avec lui. On a beaucoup d’échanges sur l’équipe de France, ce qui me permet d’avoir une vision encore plus précise et plus claire de ce qu’il veut faire, et d’être au plus près de ce qui se passe dans l’équipe. Après si l’équipe ne joue pas bien je peux toujours le dire, ça ne pose pas de problème. Il y a une façon de dire les choses, aussi.
« Les journalistes ne voient que la partie émergée de l’iceberg »
Mais il se trouve que ses résultats sont excellents, et je suis en phase avec beaucoup de choses qu’il a faites, notamment sur l’esprit de groupe. On a une confiance mutuelle, il y a des discussions que je vais avoir avec lui et que je ne vais pas utiliser dans mon travail mais qui nourrissent ma réflexion sur la direction qu’il veut prendre, et pourquoi il la prend. C’est plus facile d’expliquer les choses, les choix qui sont faits.
A un moment donné, les journalistes ne voient que la partie émergée de l’iceberg. Il leur manque une partie des éléments : tout ce qui se passe à l’entraînement, les discussions avec les joueurs, les complémentarités qui ne passent pas, tout ces éléments de ressenti au quotidien d’un entraîneur avec ses joueurs qu’on ne peut pas percevoir de l’extérieur.
Dans quelle mesure son attitude en temps que capitaine des Bleus se retrouve dans la manière dont il incarne le rôle de sélectionneur ?
Il avait déjà une vision collective dans son rôle de capitaine et de milieu défensif, dans l’équilibre attaque-défense, qu’il y ait toujours un équilibre qu’on ne parte pas à l’abordage. Il avait toujours le souci des uns et des autres pour que tout se passe bien. Il avait aussi un message positif. Quand il a décidé d’être entraîneur, pour moi il y avait une suite logique.
Le fait de porter le maillot de l’équipe de France est-il un honneur, une responsabilité, un aboutissement ? Comment l’avez-vous vécu ?
Tout ça à la fois. C’est une réelle responsabilité, parce que le maillot ne t’appartient pas. Il a une grande histoire, avec de grands joueurs qui l’ont porté très haut, il faut en être digne. Tu fais partie des meilleurs joueurs en France, tu joues les plus grandes compétitions internationales. Jouer une compétition internationale, la gagner éventuellement, c’est un aboutissement.
14 novembre 1992, première sélection contre la Finlande au Parc. Lizarazu est à l’origine du but de Cantona.
« Avant toi, il y a eu de grands joueurs, après toi, il y en aura d’autres »
Il y a beaucoup de devoirs, il ne faut pas oublier ça. Avant toi, il y a eu de grands joueurs, après toi, il y en aura d’autres. Quand j’ai joué en équipe de France, les premières fois, dans mon imaginaire d’adolescent les Bleus c’étaient Platini, Giresse, la Coupe du monde en Espagne. Quand j’ai été sélectionné, j’étais très impressionné d’être là. Je ressentais ça comme un grand privilège.
Depuis la fin de votre carrière internationale à l’Euro 2004, vous avez vu passer de nombreux titulaires au poste d’arrière gauche en équipe de France. Est-ce que Lucas Hernandez est celui qui vous ressemble le plus ?
Il me semble. Il a à la fois le côté défensif et le côté offensif, il est complet, il a la culture du duel, il aime le combat. On l’attendait plutôt sur l’aspect défensif avec la culture de l’Atlético Madrid qui est basée sur de très bons défenseurs avec la mentalité Simeone. Mais il m’a bluffé sur l’aspect offensif. Il a une très bonne qualité technique, c’est un très bon contre-attaquant. Le Bayern a fait une affaire, même s’il a coûté très cher.
Il existe beaucoup de contre-attaquants, mais je remarque beaucoup de carences défensives chez les latéraux depuis quelques temps. Alors que lui, il défend aussi très bien. Il est très complet.
30 juin 2018, et le fameux but de l’arrière droit Benjamin Pavard à la conclusion d’un centre de l’arrière gauche Lucas Hernandez.
Son arrivée, en même temps que celle de Benjamin Pavard à droite, ne vous rappelle-t-elle pas la vôtre et celle de Lilian Thuram à l’Euro 1996 ?
Ah, c’est vrai ! Je n’avais pas pensé à ça. Ça peut y ressembler. Au départ, ça devait être Sidibé et Mendy en 2018. Nous c’était Eric Di Meco et Jocelyn Angloma qui avaient fait le premier match et qu’on avait remplacé avec Lilian. Notre histoire en équipe de France a commencé comme ça, à l’Euro 96. Mais ce n’était pas pour les mêmes raisons : Sidibé et Mendy revenaient de blessure l’an dernier.
En équipe de France, vous avez connu quatre sélectionneurs (Houllier, Jacquet, Lemerre, Santini). Qu’est-ce qui explique que deux d’entre eux ont échoué et deux autres ont réussi ? Leurs choix ? Les joueurs qu’ils avaient à disposition ?
Je ne peux pas répondre à cette question, ce serait trop long, je ne vais pas rentrer dans le détail. Jacquet, il a eu une super préparation, comme l’a fait Deschamps, il a constitué un groupe, fait une préparation physique et mentale. Avec en 1998 une défense qui a été la meilleure de la Coupe du monde et un immense talent, Zidane, qui a explosé en finale.
« On est les premiers à l’avoir fait, c’est comme être le premier à marcher sur la Lune ! »
Jacquet, c’est quelqu’un de très humain, qui avait une relation très forte avec les joueurs, il m’a fait confiance alors que je revenais de pubalgie et j’avais envie de lui rendre mille fois cette confiance. Chacun d’entre nous avait une histoire particulière avec lui et ça a été une aventure magique. Gagner une Coupe du monde, c’est déjà difficile. Et à la maison… On est les premiers à l’avoir fait, c’est comme être le premier à marcher sur la Lune ! C’est quelque chose qui restera à tout jamais. Il y a un côté aventurier, c’est l’inconnu, tu touches le Graal. Et Jacquet a été un guide extraordinaire.
18 juin 1998, France-Arabie Saoudite. Lizarazu provoque l’expulsion d’Al Khilaiwi, puis offre le premier but à Thierry Henry, et marque lui-même le quatrième.
Quelle est la part de réussite, pour ne pas dire de chance, dans la conquête d’un titre européen ou mondial ? En 1998 et 2000 elle semblait très élevée, puis avait disparu en 2002…
Il y avait une continuité au niveau de l’état d’esprit même si on avait changé d’entraîneur. Les fondations ont été posées avec Jacquet et elles étaient très solides. En 2002, la blessure de Zizou, forcément ça n’a pas aidé. Il y a plein d’éléments dans la préparation qui ont posé problème par rapport à l’Euro ou à la Coupe du monde. Tu joues au top niveau pendant longtemps, il y a une forme d’usure. Le succès entraîne une forme de perturbation. Ça, la préparation tronquée et la blessure de Zizou, ça explique ce qui s’est passé.
Peut-on imaginer que l’équipe actuelle soit sur une trajectoire proche de celle de 1998-2000, et qu’à l’Euro l’an prochain elle soit plus tournée vers l’offensive et la possession, quitte à s’exposer plus en défense ?
Ce discours-là, je l’entends. Il y a des gens qui voudraient que l’équipe de France joue mieux, soit plus spectaculaire. Mais, c’est tellement difficile de construire une équipe, on ne se rend pas compte à quel point c’est difficile de manager les hommes. C’est une excellente équipe de contre-attaque. Le match contre l’Argentine, c’est l’un des plus spectaculaires de la compétition. Après la possession ce n’est pas tout. Aujourd’hui, l’équipe qui me séduit le plus, c’est Liverpool. Et pourtant ce n’est pas une équipe de possession. C’est une équipe d’attaque rapide. J’adore ce football.
« Fédérer les joueurs autour d’un projet, c’est un travail remarquable »
En club, on peut arriver à mettre une patte, comme Guardiola le fait. En sélection, c’est plus difficile. Déjà, arriver à tenir les joueurs, à les fédérer autour d’un projet, c’est un travail remarquable. Didier, il n’a pas tout gagné, il y a eu le quart de finale contre l’Allemagne au Brésil et la finale contre le Portugal à l’Euro. Mais son équipe a toujours eu de la tenue. Je pense que l’équipe de France peut être meilleure contre les équipes qui ferment le jeu, on peut faire mieux dans les attaques placées. Mais déjà, manager les mecs, c’est le travail le plus difficile.
Un dernier mot sur un club qui vous tient à cœur, le Bayern Munich. Trois internationaux ont encore été titrés fin mai (Ribéry, Coman et Tolisso). Qu’est-ce que votre passage là-bas vous a appris de plus important ?
Ça m’a transformé totalement. Ça m’a appris ce que c’est que la culture de la gagne des plus grands clubs, la force d’une institution, des grands dirigeants, le poids d’un maillot qui a une histoire fantastique. Bordeaux m’a permis d’apprendre mon métier, j’ai vécu des émotions extraordinaires, le quart de finale de coupe UEFA contre Milan AC, la remontée en D1 en 1992… Mais on n’avait pas les moyens de gagner la Coupe d’Europe.
Au Bayern, le début de saison commence, et l’objectif c’est de tout gagner. Chaque compétition. Tu as une ambition énorme. Tu ne gagnes pas tout, mais quand même. On était la bête noire du Real Madrid pendant les huit ans et demi où j’y ai joué. On battait les plus grands. Ça t’apporte de la force, de la confiance en toi.
23 mai 2001, finale de la Ligue des Champions Bayern-Valence. Lizarazu centre sur l’action qui mène au pénalty d’Effenberg et marque le sixième tir au but bavarois.
A l’époque, on partait à l’étranger à la moitié de notre carrière. On a pris conscience qu’on n’avait rien à envier aux meilleurs joueurs du monde. Et ça nous a donné confiance pour la Coupe du monde. On pouvait battre les meilleurs. Ce que je retiendrai de cette époque au Bayern, c’est l’exigence du très haut niveau, on joue tous les trois jours. Quand je suis rentré à Munich après la victoire en Coupe du monde, j’ai eu droit à un très beau cadeau, et juste après on m’a dit « c’est bien, tu es champion du monde, maintenant il faut gagner la Ligue des champions et le championnat d’Allemagne ».
« Confiance et sérénité dans les moments importants, c’est la marque des grands clubs. »
La force des grands clubs, c’est qu’il n’y a pas de pression par rapport à l’événement. Au Bayern, on n’a pas gagné tous les matchs, mais on ne s’est jamais raté sur l’événement parce que psychologiquement on n’était pas prêt, on a toujours été au rendez-vous. En 2001, on gagne le titre à la dernière journée contre Hambourg en marquant dans la dernière minute. Et quatre jours après, on joue la finale de la Ligue des Champions contre Valence et on gagne aux tirs au but. On n’a pas craqué. Confiance et sérénité dans les moments importants, c’est la force des grands clubs. C’est quelque chose qui te rentre dans les veines et en équipe de France, on en a bénéficié d’une certaine façon.
Benjamin Pavard et Lucas Hernandez vont sûrement progresser alors, en arrivant au Bayern la saison prochaine…
Ah oui ! Pavard, il est à Stuttgart qui va descendre, pour lui ça va être un énorme palier. Hernandez, avec l’Atlético Madrid, était dans une équipe qui jouait le haut du tableau chaque année. Ils vont arriver dans un club qui va les faire grandir et gagner plein de titres. Les générations se suivent et ça continue. La génération Rummenigge, Beckenbauer, Müller, Maier, a gagné trois Coupes d’Europe. Après il y a eu notre génération avec Kahn, Effenberg, Elber, Scholl, Sagnol, Paolo Sergio. Et depuis 2013 la génération Lahm, Ribéry, Müller, ils ont gagné encore une Ligue des Champions, et maintenant il y a encore plein de jeunes comme Coman, Gnabry… Tu ne peux pas te la péter au Bayern, il y a une remise en question, les anciens sont toujours là, il y a la valeur du maillot… Et au Bayern, quand tu as gagné la Ligue des Champions, tu es dans le cœur des supporters jusqu’à la fin de tes jours.