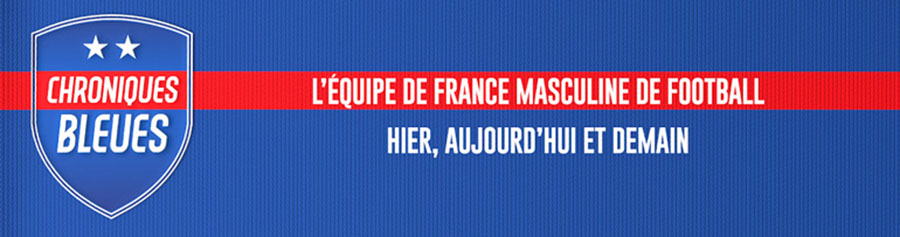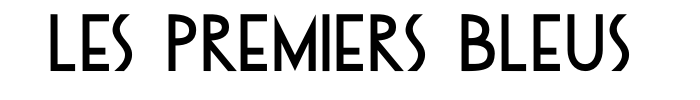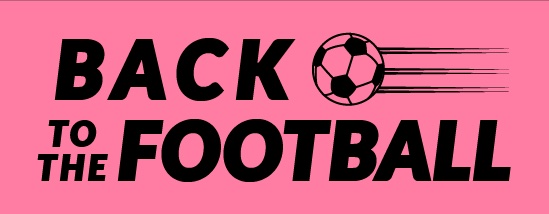Trois médias ont permis depuis 1904 aux sportsmen devenus supporters puis fans de suivre les résultats de l’équipe de France. Le premier est la presse écrite, qui relate le lendemain (voire le surlendemain) des matchs les comptes rendus des rencontres, fournissant à minima le résultat. Dans les années 1920, la radio fait son entrée en scène et offre la possibilité aux personnes possédant un poste de vivre en direct les péripéties des Tricolores. Les maisons de presse, tous comme les organisateurs de matchs, craignent tout d’abord que cette nouvelle source de diffusion de l’information fasse chuter leur chiffre d’affaires. Une trentaine d’années plus tard, l’arrivée de la télévision est accueillie avec le même scepticisme par les médias historiques. A ces sources d’information, il est possible d’ajouter Internet, qui fournit des comptes rendus écrits en quasi direct depuis la fin des années 1990. Les évolutions techniques permettent maintenant de voir les buts en léger différé, mais aussi aux supporters d’interagir entre eux sur les réseaux sociaux.
Septembre 1922 : la boxe, premier sport à la radio en France
Le premier événement sportif radiodiffusé en France serait le combat de boxe opposant Georges Carpentier à Battling Siki le 24 septembre 1922. D’autres sources évoquent, toujours en boxe, le duel entre Eugène Criqui et Henri Hébrans, qui a eu le 6 octobre 1923 dans la salle Wagram à Paris. Le direct sur le Tour de France n’arrive pour sa part qu’en 1929.
En 1924, les Jeux olympiques de Paris donnent l’occasion à la France de montrer son savoir-faire en matière de technologies. Edmond Dehorter, radioreporter connu sous le nom du Parleur Inconnu [1], assure les commentaires des épreuves même si la presse écrite craint que ce média n’éloigne le public du stade et ne porte préjudice aux ventes de journaux. Cette défiance est telle que les organisateurs interdisent l’accès au stade à Dehorter. Qu’à cela ne tienne, ce dernier monte dans la nacelle d’un ballon dirigeable pour commenter en direct la finale de football opposant l’Uruguay à la Suisse (victoire des Sud-américains 3-0). Les commentaires de la rencontre sont parfois impossibles, lorsque le vent déplace le ballon et empêche Dehorter de voir la pelouse. Même s’il n’existe aucune certitude, les rencontres de la France (face à Lettonie le 27 mai, puis l’Uruguay le 1er juin) n’auraient pas été radiodiffusées.

-
L’Auto du 21 février 1928 (BNF, Gallica)
L’équipe de France en direct dans les foyers
Il semblerait que ce soit le 21 février 1928 que l’équipe de France ait les honneurs des ondes pour la première fois, lors du match joué à Buffalo opposant les Tricolores aux Nord-Irlandais, sur Paris-PTT, la radio d’Etat relayée à Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille, Limoges, Grenoble et Rennes. La prise d’antenne par Edmond Dehorter a lieu dès 14 heures avec la retransmission du match de l’équipe militaire française face au onze anglais suivi de la rencontre France-Irlande du Nord à 15 heures 45. La diffusion de cet événement signalé dans L’Auto et Ouest-Eclair ne fait par la suite l’objet d’aucun compte-rendu dans la presse. En avril, une ligne spéciale est mise en place avec l’administration des PTT pour permettre aux Portugais de suivre depuis Lisbonne le match France-Portugal disputé à Buffalo [2].
Les rencontres des Tricolores à domicile sont régulièrement radiodiffusées depuis 1928, même si quelques rencontres font exception. Ainsi, à la demande de la fédération autrichienne, la FFFA refuse toute retransmission du match France-Autriche joué le 12 février 1933 [3]. Il semble qu’il faille attendre le 19 mars 1933 pour qu’une rencontre disputée à l’extérieur, en l’occurrence le match Allemagne-France, soit radiodiffusé en France [4]. Cette rencontre est toutefois l’occasion d’une initiative intéressante du journal Le Messin qui installe un poste dans la cour de ses locaux pour permettre aux supporters n’étant pas équipés de suivre la rencontre [5]. Une sorte d’écran géant avant l’heure en somme.

-
L’Auto du 29 avril 1928 (BNF, Gallica)
La question de pertinence de diffuser ou non les rencontres internationales est posée en mars 1934 lors d’une réunion de la FFFA. Henri Jooris y souligne qu’un tel évènement risque de pousser une partie du public à quitter les gradins du championnat pour suivre les radiodiffusions. Ce point est reconnu comme possible, mais il est décidé que « en sport comme dans la vie, l’intérêt général doit passer. » [6]
Pour contourner cette question, de drôles de solutions sont parfois mises en place : diffuser au cours des rencontres se jouant dans les stades les commentaires des rencontres de l’équipe de France-Belgique, qui se disputent ailleurs mais au même moment. C’est le cas par exemple du France du 26 mars 1933, que le public de la rencontre Lorrach-SUL a pu suivre grâce à la société CLAGE qui radiodiffuse la rencontre internationale [7].

-
L’Auto du 29 avril 1928 (BNF, Gallica)
Les Coupes du monde 1934 et 1938 sur les ondes
En 1934, Georges Briquet sur l’antenne du Poste Parisien et Gautier-Chaumet sur celle de Radio-Paris font vivre aux Français la défaite de la France en huitième de finale de la Coupe du monde contre l’Autriche à Turin (2-3 après prolongations), la diffusion étant permise grâce à l’amabilité des autorités italiennes [8]. La couverture de l’édition de 1938 en France est très large et des accords sont passés avec de nombreux pays pour permettre aux supporters de suivre l’épreuve de partout dans le monde, même depuis le Brésil [9]. A l’issue de l’épreuve, L’Auto souligne le grand succès de la radiodiffusion de l’épreuve à travers la planète [10]. Pour la télévision, il faudra attendre encore une vingtaine d’années.

-
L’Auto du 21 juin 1938 (BNF, Gallica)