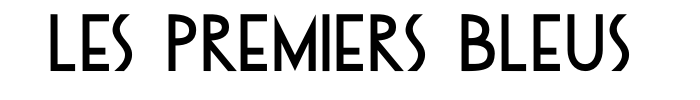Lire les articles Espagne 82, ou quand la nostalgie refait surface et Espagne 82, une machine à remonter le temps
En 1982, vous aviez 14 et 16 ans. Comment avez-vous suivi et vécu cette Coupe du monde ?
BRUNO COLOMBARI : Mes parents n’avaient pas la télévision à cette époque, et ils en ont acheté une d’occasion (qui ne marchait pas très bien d’ailleurs, le bleu tirait un peu sur le vert, ce qui n’était pas pour me déplaire) quelques semaines avant le tournoi. J’étais au lycée, je finissais mon année de seconde. Je n’avais pas le maillot des Bleus mais la tenue d’entraînement rouge et bleue qu’on peut trouver sur des photos de l’époque. D’ailleurs pour mon anniversaire, qui tombait la veille de France-Angleterre, j’avais demandé un maillot de l’Angleterre (le blanc), que j’ai porté le jour du match. Ce qui était bien, c’était de voir plein d’équipes qu’on ne connaissait pas ou qu’on ne voyait que dans les magazines. Et avec un copain, on se faisait (déjà) des tableaux dans lesquels on notait les scores et où on faisait les classements des groupes. Un embryon de Chroniques bleues, on dira !
RICHARD COUDRAIS : J’étais également chez mes parents. J’ai surtout vu les matchs de 17h15, en arrivant tout juste de l’école. Pour ceux de 21h, il fallait encore négocier pour en voir tout ou partie. Mon année scolaire ne plaidait pas vraiment en ma faveur. Heureusement, mon père avait eu la bonne idée, juste avant le tournoi, d’équiper le foyer de l’invention du siècle : le magnétoscope ! J’ai donc pu voir le mercredi et le week-end pas mal de matchs en replay. Ça a vraiment été la première période où je me suis gavé de football. Avec la télé, mais aussi la lecture : Je découvrais certains résultats de la veille au soir dans le journal régional du matin, mais aussi dans L’Équipe. Mes parents tenaient un bistrot et un client me laissait parfois son exemplaire. Puis je me procurais France-Football, Mondial, Onze… je découvrais quelques facettes du récit footballistique. En outre, le tournoi m’a permis de faire de notables progrès en géographie. Je n’avais jamais entendu parler du Honduras, par exemple.

Pourriez-vous nous rappeler le contexte historique de ce début des années 1980 ? Pensez-vous que les événements de la planète ont eu un impact, qu’il soit sportif ou autre, sur le déroulement de cette Coupe du monde ?
BRUNO COLOMBARI : C’est une période historiquement très chargée, bien qu’elle arrive sept ans avant la chute du Mur de Berlin, neuf ans avant la fin de l’URSS et un peu moins de vingt ans avant les attentats du 11-Septembre. Le monde de 1982 n’avait rien à voir avec le nôtre, mais il le contenait déjà en germes, comme Espagne 82 préfigurait l’évolution du tournoi au 21ème siècle. Les trois principaux points chauds, cette année-là, se situent en Pologne, où Solidarnosc est matée par le pouvoir polonais, du moins pour l’instant, au Liban, ravagé par une guerre civile alimentée par un conflit qui le dépasse et le traverse, et dans l’Atlantique Sud, où l’Argentine et le Royaume-Uni sont en guerre pour quelques ilôts stratégiques.
Bruno Colombari : « après tout, il s’est passé autant de temps entre aujourd’hui et 1982 qu’entre 1982 et le milieu de la Seconde Guerre mondiale... »
C’était tellement complexe qu’on a décidé de faire appel aux compétences d’un spécialiste de la Guerre froide, l’historien Pierre Grosser. Le contexte historique a évidemment pesé sur la compétition, parce que s’il n’y a pas eu d’Argentine-Angleterre, il y a bien eu un Pologne-URSS. Mais ça s’est arrêté là. Ceci dit, le France-RFA de Séville a réveillé lui aussi des sentiments belliqueux finalement pas si enfouis que ça, et qui a d’ailleurs nécessité un communiqué commun entre François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl. Mais ce n’est pas étonnant : après tout, il s’est passé autant de temps entre aujourd’hui et 1982 qu’entre 1982 et le milieu de la Seconde Guerre mondiale...
La Coupe du monde 1982 avait sa mascotte. Chaque ville avait aussi sa propre affiche. Peut-on dire que le marketing visuel de la coupe du monde a démarré en 1982 ou était-ce un phénomène qui existait déjà avant ? Comment jugez-vous son évolution depuis 40 ans ?
RICHARD COUDRAIS : Les visuels promotionnels sont nés bien avant 1982. La première mascotte date de 1966, le premier logo de 1970. L’affiche officielle est une tradition née dès le début, en 1930 et les affiches des différentes éditions constituaient déjà une belle collection. Le tournoi espagnol a sublimé l’exercice en invitant les plus grands artistes contemporains de l’époque : Miró pour l’affiche officielle, et une poignée de grands artistes de styles différents pour chacune des villes organisatrices (il y en avait 14). Aucun tournoi n’a fait mieux depuis. On aurait bien aimé piocher dans ces visuels pour la couv ! Ça n’a pas pu se faire.
La mascotte du mundial 1982 est particulièrement réussie. La mode était aux petits garçons, mais les Espagnols ont préféré une orange, Naranjito, qu’ils ont inclus dans une série animée qui racontait l’histoire de la Coupe du monde. C’était une mascotte dessinée. On l’a peu vue sous la forme qu’on connaît aujourd’hui, celle d’un comédien déguisé. Par la suite, on a eu d’autres mascottes sympa en Coupe du monde. Elles font systématiquement débat et on retient surtout les ratages, comme celle de 2006.

Richard Coudrais : « L’Algérie, le Cameroun et le Honduras ne se sont pas contentés de faire de la figuration »
Pour la première fois, 24 équipes étaient qualifiées pour la coupe du monde (contre seulement 16 lors des éditions précédentes). Cela a permis d’ouvrir l’épreuve vers de nouveaux horizons. Mais est-ce que cela a eu des impacts sur le jeu ?
RICHARD COUDRAIS : Le passage de 16 à 24 équipes à été l’aspect le plus spectaculaire de cette Coupe du monde. Le tournoi se jouait à seize depuis l’origine (du moins quand il n’y avait pas de forfaits), mais il y avait nécessité à ouvrir le tournoi aux continents un peu délaissés jusqu’alors. Les représentants de ces continents, qui apparaissaient tous pour la première fois (hormis le Salvador), ont apporté beaucoup de fraîcheur au tournoi. L’Algérie, le Cameroun et le Honduras notamment ne se sont pas contentés de faire de la figuration. Ces équipes avaient de bons éléments et étaient bien préparées. C’était une découverte, il y avait très peu de joueurs qui évoluaient hors de leur pays d’origine. On a eu un premier tour passionnant et cela a donné raison aux partisans de l’agrandissement du tournoi. Dans les éditions suivantes par contre, la pertinence de cet élargissement sera plus discutée.
BRUNO COLOMBARI : Je dirais que c’est moins l’ouverture à de nouvelles nations qui a eu de l’impact, que le format hybride (et abandonné dès l’édition suivante précédente) avec son deuxième tour composé de quatre groupes de trois et des demi-finales qui avaient disparu en 1974 et 1978. Ce deuxième tour a fortement pénalisé les équipes qui ont joué le deuxième et le troisième match, comme le Brésil, l’Irlande du Nord, l’Espagne et l’URSS, puisqu’aucune d’entre elles ne s’est qualifiée. Et il a généré des groupes déséquilibrés, avec l’Italie, l’Argentine et le Brésil ensemble ou encore l’Angleterre, la RFA et l’Espagne, alors que la France, l’Irlande du Nord et l’Autriche semblaient sur le papier être d’un niveau moindre. Le fait qu’il n’y ait eu que quatre matchs à élimination directe sur 52 a engendré beaucoup de calcul à chacun des deux tours, même si certains ont produit du spectacle et des surprises.
Effectivement, l’organisation du calendrier était loin d’être parfaite. Le déroulement du premier tour, avec les derniers matchs joués en décalés, ainsi que le second tour, où les équipes avaient entre 3 et 6 jours entre leurs rencontres, n’était pas équitable. Quels problèmes cela a engendré et quelles ont été les conséquences sur les éditions suivantes ?
RICHARD COUDRAIS : Le premier tour était organisé de façon à avantager ouvertement les têtes de série. Celles-ci disputaient leurs trois rencontres du premier tour dans le même stade, alors que leurs adversaires se déplaçaient. En outre, leur troisième match était décalé de 24 heures, alors qu’habituellement, ces rencontres se jouent dans le même temps. Cela créait un avantage très important, le match RFA-Autriche allait le démontrer. Lorsque qu’elles ont atteint le score de 1-0 qui les arrangeait toutes les deux, les deux équipes sont restées en position d’attente jusqu’à la fin du match, sous les sifflets du public. Depuis, les organisateurs veillent à ce que les troisièmes rencontres soient systématiquement jouées le même jour à la même heure. Quant au même stade pour les trois rencontres du premier tour, le principe a été ébréché en 1994 puis abandonné pour de bon à partir de 1998.
Pour le second tour, on a expérimenté pour la première fois une formule de groupes à trois équipes, qui est par nature inéquitable. La France a su en tirer parti, tant mieux pour elle, mais la formule a désavantagé le Brésil, entre autres.
BRUNO COLOMBARI : Ce format mal fagoté avec un second tour à douze à la place de huitièmes et de quarts de finale est mort-né puisque dès 1986 au Mexique, ces derniers sont rétablis. S’il y avait eu des quarts de finale en 1934, 1938 et de 1954 à 1970, les huitièmes étaient plus rares, puisqu’on en retrouve que lors de la deuxième et de la troisième édition, où ils tenaient lieu de premier tour. Mais pour passer de 24 équipes à 16, il fallait récupérer les quatre meilleurs troisièmes de la phase de poule, ce qui n’avait pas vraiment de sens. Ce format a été depuis 2016 adopté en championnat d’Europe. Il faudra attendre 1998 pour que le tournoi mondial retrouve une cohérence avec 32 participants et 16 qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais ça ne va pas durer, puisque dès 2026 il y aura 48 équipes avec 16 groupes de trois pour le premier tour, ce qui rappellera le second tour de 1982, sauf qu’il ne pourra pas y avoir de match nul.
Nous allons effectivement passer à 48 en 2026. Que pensez-vous de cette augmentation du nombre de participants ? Quelle serait pour vous la meilleure formule à appliquer ?
RICHARD COUDRAIS : Quarante-huit équipes, c’est beaucoup trop, ça n’a aucun sens. Depuis que l’on est passé à 32 équipes, et même avant, le premier tour ressemble plus à un prolongement des éliminatoires qu’à la compétition en elle-même, laquelle, comme l’annoncent souvent les médias, ne démarre qu’à partir des huitièmes de finale. Pour ma part, je pense qu’une phase finale devrait se jouer à seize équipes. C’était le standard des Coupes du monde jusqu’en 1978 et le format à boosté l’Euro entre 1996 et 2012. C’est inimaginable aujourd’hui, mais la Coupe du monde aurait beaucoup à gagner en revenant à seize équipes, avec un premier tour à quatre groupes de quatre, qui qualifie les deux premiers pour les quarts de finale. On aurait un tournoi de trois semaines avec des gros matchs dès le premier tour.
BRUNO COLOMBARI : C’est effectivement une idée intéressante, même si je trouve que le format à 32 était satisfaisant, avec une bonne représentation des différents continents et un équilibre entre le premier tour à huit groupes de quatre et une phase à élimination directe dès les huitièmes de finale. Mais il a l’inconvénient d’être lourd avec 64 matchs, un mois de compétition et une dizaine de stades nécessaires. Si on devait revenir à seize (ce qui est très improbable), je serais encore plus radical : suppression du premier tour remplacé par des huitièmes de finale comme en 1934 et 1938, et répartition continentale comme aux JO. Quatre sélections européennes, quatre asiatiques, quatre africaines et quatre américaines (sud, centre et nord confondus). Histoire d’éviter que la Coupe du monde soit une sorte d’Euro dès les quarts de finale. Bon, c’est une hypothèse encore moins probable que celle de Richard !
Bruno Colombari : « Côté équipe de France, la révélation principale a été Manuel Amoros »
Revenons à la Coupe du monde 1982. Quels joueurs se sont révélés ou ont répondu aux attentes placées en eux lors ce mondial ? Est-ce que tous ont réussi à confirmer par la suite ?
RICHARD COUDRAIS : Traditionnellement, la Coupe du monde apportait à chaque édition son lot de nouvelles têtes. La médiatisation du foot n’était pas aussi répandue qu’aujourd’hui, et les meilleurs joueurs du globe n’étaient pas concentrés dans les championnats européens. La Coupe du monde permettait de découvrir de nouveaux joueurs, et l’édition espagnole nous en a donné beaucoup, notamment ceux des nations nouvelles comme le Cameroun (N’Kono, Abega…), l’Algérie (Madjer, Assad…), le Honduras (Costly, Arzu…). La Coupe du monde a mis ces joueurs en lumière et les meilleurs ont été recrutés par un club européen juste après le tournoi. Aujourd’hui, les talents du monde entier sont dans le viseur des plus grands clubs dès l’adolescence, ils arrivent en Europe avant leurs 20 ans. L’effet de “découverte” est moins présent en Coupe du monde.
Les nations habituelles ont également apporté leurs lots de découvertes, ces joueurs un peu méconnus, à l’ombre des stars, qui ont littéralement éclaté sous le soleil espagnol : l’Italien Conti, l’allemand Littbarski, les Polonais Buncol et Smolarek, quelques Français, le Brésilien Eder… On peut ajouter d’autres joueurs qui ont grandi grâce au tournoi, des Anglais, des Belges, des Soviétiques, notamment leur magnifique gardien Dasaev. Et puis il y a la catégorie poids lourds, les joueurs déjà reconnus, niveau Ballon d’Or, pour lequel le tournoi fut un sommet comme les Italiens Rossi et Zoff, le Polonais Boniek, les Brésiliens Socrates et Zico. On peut ajouter l’Allemand Rummenigge et notre Platini, même s’ils étaient un peu blessés. Maradona était très attendu, un peu trop même, et il a fini le tournoi sur un carton rouge. Il a reporté son sacre annoncé de quatre ans. Enfin, il y a les “figures”, ces joueurs emblématiques dont le nom nous ramène à ce tournoi, comme Gentile, Schumacher ou Valdir Peres. Des personnages importants, qui donnent du relief au récit.
BRUNO COLOMBARI : Côté équipe de France, la révélation principale a été Manuel Amoros. C’est un joueur qui n’avait que vingt ans (comme Bruno Bellone, plus jeune de deux mois), qui avait débuté en sélection en février contre l’Italie et qui venait d’être champion de France avec Monaco. Mais contrairement à Ettori et Couriol, lui s’est imposé en défense à la place de Battiston. Il a fait un match énorme à Séville où il a joué à gauche, Bossis passant à droite. Son sang-froid au moment des tirs au but était incroyable, tout comme après son tir sur la barre à la 90e minute. Il a fini sa carrière dix ans plus tard avec 82 sélections. S’il a raté l’essentiel de l’Euro 84, il a été déterminant en 1986 au Mexique.
Genghini, Giresse et Tigana n’étaient pas des révélations, mais ils ont prouvé ensemble, contre l’Autriche, qu’avec eux l’équipe de France était bien plus forte. Mais le premier a été sacrifié dès l’automne avec l’arrivée de Luis Fernandez. Gérard Soler a fait un bon tournoi, ne manquant que le match de Séville. Mais on ne l’a plus beaucoup vu par la suite. Bruno Bellone, c’est le contraire : il ne joue que le match de classement contre la Pologne, mais il fait une belle carrière par la suite, en marquant le dernier but de l’Euro 84 et en faisant des rentrées intéressantes au Mexique.
Richard Courdrais : « l’orgiaque Hongrie-Salvador (10-1) où la plupart des buts sont beaux »
En tant que Français, nous avons tous en mémoire ou entendu parler de la demi-finale de Séville. Mais d’autres matchs ont marqué cette coupe du monde, par leur scénario ou la qualité du jeu. Pourriez-vous nous en parler ?
RICHARD COUDRAIS : Il y a au Séville, bien entendu, mais également, trois jours plus tôt, un Italie-Brésil tout aussi traumatisant pour les amoureux du beau jeu. Les cinq matchs du Brésil ont été de beaux spectacles, ceux de l’équipe de France au deuxième tour également. Ensuite, on peut relever le show de Boniek lors de Pologne-Belgique ou celui de Maradona face à la Hongrie, les vingt minutes de folie de la Pologne face au Pérou, la victoire de l’Algérie contre la RFA et sa première mi-temps face au Chili, le décisif Ecosse-URSS, riche en rebondissements, l’orgiaque Hongrie-Salvador (10-1) où la plupart des buts sont beaux… On a revu pas mal de rencontres sur Footballia et certaines se sont révélées plus intéressantes que ce que notre souvenir en avait gardé. La finale par contre, on confirme : ce n’était pas terrible.
BRUNO COLOMBARI : c’était une autre époque, et d’une certaine manière, c’était un autre football. Nous avons d’ailleurs consacré un chapitre à l’arbitrage et à l’évolution des règles, qui ont changé le jeu de façon importante : il n’y avait que deux remplacements possibles à l’époque, et parmi quatre joueurs de champ (plus un gardien), ce qui veut dire que six autres joueurs suivaient le match en tribune. On en a vu les conséquences à Séville, où Genghini, milieu relayeur plutôt offensif, a été remplacé par Battiston, arrière latéral, lequel a lui-même laissé sa place à Lopez, défenseur central. Il n’y avait aucun milieu sur le banc français…
Quand on revoit les matchs, le jeu est plus lent qu’aujourd’hui, avec beaucoup moins d’intensité et des fautes qui n’étaient pas sifflées alors qu’elles entraîneraient aujourd’hui un rouge direct. Mais quelle qualité technique ! Le toucher de balle, les passes longues, les contrôles orientés, les coups de pied arrêtés, notamment les coups francs directs… C’est amusant de chercher les petits détails qui changent, comme ces corners où le tireur doit faire dégager les photographes qui ne lui laissent même pas un mètre d’élan. En tout cas, c’était un plaisir ces heures passées à redécouvrir ces matchs que quatre décennies avaient estompés. On espère que les lecteurs en prendront autant que nous !
Comme tu le dis, le football a changé depuis 1982. La finale a d’ailleurs marqué la victoire du réalisme sur le le beau jeu. Peut-on dire que cette Coupe du monde marque le début du “résultat avant tout” qui prime de plus en plus sur le spectacle ?
RICHARD COUDRAIS : C’est une conclusion que l’on a souvent tiré puisque la finale a opposé deux équipes pragmatiques, vainqueurs des favoris jugés plus “romantiques”. Mais je ne pense pas qu’il y ait eu un basculement en 1982. Dans le passé, des équipes offensives comme la Hongrie et les Pays-Bas se sont cassées les dents face au pragmatisme allemand. A contrario, le Brésil de 1970 a écrasé la finale aux dépens du catenaccio italien. Après 1982, on verra encore le Brésil et la France jouer la fleur au fusil au Mexique, les deux équipes seront même opposées dans un quart de finale de rêve. Mais ensuite, la plupart des sélections joueront la sécurité en consolidant leur défense. Je pense qu’il s’agit d’une évolution “naturelle” du football, où la défaite est de moins en moins acceptée.
BRUNO COLOMBARI : La Coupe du monde 1978 avait été très réaliste aussi, et celle de 1990 ne sera pas mal non plus dans le genre. On constate depuis une baisse assez nette du niveau des sélections, hélas, et encore plus lors des phases finales qui se déroulent à la fin de saison très chargées pour les internationaux qui jouent la Ligue des Champions, laquelle cannibalise tout. Si on peut dire que les finales 1998 et 2018 ont été plutôt spectaculaires, c’est moins par un niveau technique exceptionnel du vainqueur (la France en l’occurrence) que par un effondrement défensif du vaincu, en première mi-temps pour le Brésil, en seconde pour la Croatie. On verra si la Coupe du monde au Qatar, qui se jouera à la fin de l’automne, offrira plus de jeu avec des joueurs a priori plus frais.
Pour terminer, comment imaginiez-vous la suite de l’histoire pour les Bleus après ce beau parcours qui marquait la fin de près de 25 ans de piètres résultats ?
BRUNO COLOMBARI : L’objectif était évidemment l’Euro 84 organisé en France, mais comme c’était une compétition à huit qui n’avait eu qu’un précédent sous ce format (en 1980 en Italie), ça semblait difficile quand même de la gagner. On ne pouvait pas prévoir que l’Angleterre, l’Italie, l’URSS et la Pologne, qui avaient brillé en Espagne, n’y participeraient pas. Ni que le Danemark et le Portugal, qui avaient manqué 1982, seraient dans le dernier carré. Pour moi, le vrai espoir était dans l’édition 1986 (alors prévue en Colombie), même si ça semblait très loin. En tout cas, j’avais très envie de revoir cette équipe en phase finale : en un mois, il s’était passé tellement de choses !
RICHARD COUDRAIS : J’ai pris le train en marche en 1978. L’échec en Argentine m’avait enseigné qu’il ne fallait pas être trop exigeant avec les Bleus, que les autres étaient largement plus forts. En Espagne, passer le premier tour, c’était déjà bien. Mais après Séville, on se dit qu’on peut espérer beaucoup. Un titre européen paraissait envisageable, d’autant que le tournoi allait être organisé à la maison. Après, comme dit Bruno, l’édition 1986 paraissait loin. Avec le recul aujourd’hui, il est clair que l’équipe de France a changé de dimension au cours du tournoi espagnol. Jusqu’alors on avait une équipe irrégulière, un peu “championne du monde des matchs amicaux”, l’épopée de Suède était presque un heureux accident. L’équipe d’Hidalgo a été la première équipe à bénéficier du travail de formation mis en place au début des années 1970. On avait désormais une approche plus professionnelle, plus conquérante, plus pérenne. Mais ça, il m’a fallu quarante ans pour l’analyser.