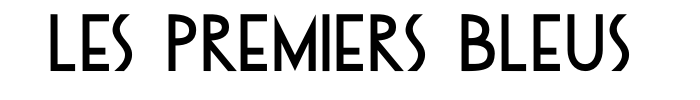Pierre Cazal est un contributeur essentiel à Chroniques bleues depuis 2019, après en avoir été la source principale avec son Intégrale de l’équipe de France publiée en 1998. Il est l’auteur d’une centaine d’articles et alimente chaque semaine sa série biographique sur les premiers Bleus. Il a aussi publié récemment trois livres, Sélectionneurs des Bleus (Mareuil, 2020), L’épopée des Bleus à l’Euro (Mareuil, 2021) et Une histoire tactique des Bleus (Spinelle, 2022).

Autant dire que j’ai immédiatement pensé à lui quand, quelques jours après France-Gibraltar, je me disais qu’on venait d’assister à un match du début du vingtième siècle, quand les scores à trois chiffres (dont deux pour le vainqueur) n’étaient pas rare. Mais qu’il était évidemment absurde de faire un parallèle à plus de cent ans d’intervalle entre ce qui était une activité d’amateurs sans grande importance et le sport le plus répandu sur la planète, médiatisé dans ses moindres recoins et générant l’équivalent du PNB d’un Etat.
Le match France-Gibraltar a parfois donné l’impression d’une rencontre du début du vingtième siècle, avant la Grande Guerre, quand ce genre de score (14-0) n’était pas rare. Quels points communs pourrait-on trouver entre ce match-là et ceux perdus dans les grandes largeurs par l’équipe de France des origines ?
L’équipe de France s’est trouvée dans la position humiliante de Gibraltar en 1906 (0-15 face à l’Angleterre), en 1908 (1-17 face aux Danois) et même encore en 1927 (1-13 face aux Hongrois), sans parler du 0-20 d’Ipswich en 1910, mais il ne s’agissait alors que de l’équipe de l’USFSA, qui n’était plus affiliée à la FIFA, ce qui sur le fond ne changeait rien.
Le point commun, c’est l’écart de niveau. Il est abyssal aujourd’hui entre la France, n°2 mondial, et Gibraltar, à peu près 200e, les causes en sont évidentes, inutile de les rappeler ici. Pire, il n’a aucune chance de se combler ; ce qui ne veut pas dire que Gibraltar prendra toujours dix buts face à la France. Car, pour en arriver à un tel score, l’euphorie, d’un côté, et le découragement, de l’autre, jouent leur rôle. En 1906, la France avait pris six buts à la mi-temps ; pareil en 1908 et même en 1927, et sans en rendre un seul. Gibraltar, sept. Dans un pareil cas de figure, le match est perdu, dans la tête des joueurs, et ils ne se battent plus : l’addition grimpe en seconde mi-temps, pour peu que l’adversaire se comporte en fauve, et cherche le carton.
Mais ce qui est intéressant à noter, c’est que l’écart de niveau de la France par rapport à l’Angleterre ou au Danemark, incontestables n°1 et n°2, en Europe du moins, d’avant 1914 s’est réduit assez rapidement : dès 1913, les Bleus ne perdaient plus que 1-4. En 1945, la France arrachait un 2-2 à Wembley, puis gagnait l’année suivante 2-1 à Paris (je précise, pour les puristes , que la victoire 2-1 de 1921 n’a aucune signification, car l’amateurisme était alors mort en Angleterre, tué par le professionnalisme, comme l’amateurisme français plus tard).
« Le football anglais était en avance, tant du point de vue athlétique que tactique »
Aujourd’hui, il n’y a pas d’écart de niveau entre le football français et le football anglais : on a donc pu gommer dix buts d’écart ! Pourquoi ? Parce que le football anglais était en avance, tant du point de vue athlétique que tactique : le premier match international y datait de 1872, contre 1900 aux Français, le championnat professionnel de 1888. Les Anglais ont stagné (leur boycott de la Coupe du monde avant 1950 n’y a pas été pour rien), et les Français ont progressé, à partir du moment où ils ont instauré le professionnalisme en 1932. Quant aux Danois, leur refus du professionnalisme les a fait régresser, avant de remonter dans les années 1990, mais pas au sommet : leur succès (lunaire) à l’Euro 92 ne s’est jamais traduit en Coupe du monde.
A l’inverse, évidemment, le contexte de France-Gibraltar n’a rien à voir avec ceux d’il y a plus d’un siècle. Première différence, évidente, l’aire de jeu. Autre différence flagrante, l’équipement. Et en particulier les chaussures et le ballon. Enfin, les règles du jeu et l’arbitrage, qui se pratiquait sans assistance, ont bien changé aussi...
On joue , avant 1914, avec de grosses bottines de cuir, bien rigides, pourvues de pointes (les crampons vissés datent de 1930 environ), le ballon est une vessie de caoutchouc gonflée et recouverte de panneaux de cuir lacés, qui s’imbibe dès qu’il pleut et double de poids (la plastification ne date que des années 1960) ; il s’en faut que les pelouses soient des billards, elles sont souvent inégales, voire bombées, l’herbe y est parfois rare, et haute, mais cela n’a jamais eu d’impact sur le jeu, la preuve, on marquait beaucoup plus de buts alors qu’aujourd’hui.
Quant aux règles, on peut considérer que, depuis 1902, le jeu est très semblable à celui d’aujourd’hui : exception importante, le hors-jeu. Il fallait trois joueurs (en comptant le gardien), et non deux comme aujourd’hui (et à partir de 1925) entre le porteur du ballon et les cages pour être en jeu, ce qui facilitait le travail des arrières et empêchait les avants adverses de se positionner en pointe, d’où la classique attaque en ligne ; pas de remplacements (du moins en compétition) avant 1967, mais était-ce un handicap ? Je ne le crois pas. La multiplication des remplaçants, jusqu’à 5, voire 7, dénature le jeu, et il est prouvé qu’elle ne sert presque toujours à rien. La statistique démontre que très peu de remplaçants ont été décisifs, soit en scorant, soit en passant. Le jeu est haché par ces rentrées incessantes, le rythme est cassé et cela nuit au spectacle sans améliorer le résultat. Osera-t-on revenir en arrière ?

-
Le Sport Universel Illustré, 7 juillet 1900 (BNF, Gallica)
La médiatisation a aussi radicalement changé. Toi qui fait des recherches très poussées dans les journaux d’époque, peux-tu expliquer comment un match était relaté dans la presse, et à quel point même les photos étaient rares et de piètre qualité ?
Je voudrais préciser la façon dont on peut aujourd’hui se faire une idée du jeu des années 1900 ; car il n’existe à peu près aucun film, aucune vidéo d’époque, alors qu’au contraire, on croule actuellement sous les diffusions télévisées venues de la Terre entière (rien de plus facile que de voir, en replay, un Brésil-Argentine joué à Rio ou à Buenos-Aires, par exemple), et que tous les matchs des Bleus, toutes les phases finales des Coupes du monde sont diffusées : le spectateur et l’analyste se régalent !
Mais avant 1914, il n’y a rien. Quasiment rien non plus avant 1954, d’ailleurs… La première finale de Coupe du monde qu’on peut voir in extenso, c’est Allemagne-Hongrie 1954, et il ne faut surtout pas se priver ! Et pour l’équipe de France, on ne dispose que de résumés d’actualités (diffusées alors dans les cinémas, avant les films), à partir de 1945.
Alors comment faire, si l’on veut être un tant soit peu objectif ? On dispose de sources écrites : les comptes-rendus des journaux sportifs, tout d’abord : ils décrivent les actions de jeu, jugent les performances individuelles des joueurs, ce qui donne des informations, mais embryonnaires et subjectives. Il y a aussi, et c’est précieux, le manuel de Fraysse et Tunmer, datant de 1897, intitulé Football. Les auteurs y décrivent avec précision la façon dont les joueurs, poste par poste, doivent jouer, et cela permet très bien d’imaginer la tactique d’une équipe évoluant en 2-3-5 avant 1900.
Mais cela reste théorique et idéal. Enfin, il y a les photos de jeu. La plupart des photographes sont postés derrière les cages, de sorte que leurs photos ne montrent que des actions de but, toujours un peu semblables, c’est de peu d’intérêt. Par contre, exceptionnellement, on peut tomber sur des photos d’ensemble, grand angle, qui montrent tout le champ de jeu, ou du moins une partie, et les positions des joueurs, tels des pions disséminés sur le terrain : ces photos-là permettent le mieux de se représenter le jeu, comme ce que l’on peut voir sur son écran de télévision aujourd’hui, le mouvement en moins. La comparaison est parlante. C’est donc sur ces bases que je fonde les remarques qui vont suivre, qui se veulent objectives et factuelles, dans la mesure où on peut l’être, c’est-à-dire très imparfaitement.
Passons justement à la tactique. Tu expliques souvent dans la série Les premiers Bleus que les attaquants ne se replient pas dans leur moitié de terrain et laissent les défenseurs se débrouiller, ce qui devait laisser des espaces considérables entre le rond central et la surface de réparation, notamment dans des matchs très déséquilibrés…
Ce qui frappe, quand on examine ces clichés, c’est la distance qui sépare les joueurs les uns des autres, on ne se marque pas « à la culotte », il y a des espaces. Il arrive que les joueurs s’agglutinent, bien sûr, mais sur corner. Autrement, le jeu en « bloc-équipe », comme pratiqué aujourd’hui, avec des lignes resserrées, qui coulissent autant latéralement que verticalement, n’existe pas. Une équipe occupe toute la largeur du terrain, les ailiers collés aux lignes de touche, et les demis-aile, chargés de les gêner, près d’eux, mais pas collés à eux. On attaque « en ligne », comme au rugby, c’est-à-dire que toute la ligne avance en même temps, il n’y a pas de jeu en profondeur, ou alors seulement pour courir après un ballon dégagé à l’aveugle par un arrière.
« On voit parfaitement sur les clichés des joueurs arrêtés qui observent »
Le résultat de cette tactique, c’est l’absence de cohésion. Aujourd’hui, une équipe peut échanger une vingtaine de passes, en allant de gauche à droite et vice-versa pour trouver une ouverture ; une ou deux touches de balle, pas plus, pour chaque joueur, peu de dribbles d’élimination, beaucoup de « jeu sans ballon », de manière à offrir au porteur du ballon des solutions.
Rien de cela avant 1914, les journalistes le dénoncent en permanence, et certains joueurs, comme Gabriel Hanot, également. Le jeu est individualiste : on porte le ballon, on dribble, on court, on passe aussi à son voisin, mais l’équipe ne bouge pas ensemble, on voit parfaitement sur les clichés des joueurs arrêtés qui observent, loin de l’action. Le jeu n’est pas organisé comme il l’est actuellement, il est improvisé, par à-coups, par ruades, et cela s’explique par le fait qu’il n’existe pas de coach.

-
La Vie au Grand Air, 21 avril 1904 (BNF, Gallica)
L’avantage de la situation, c’est qu’on ne voit jamais deux lignes de quatre joueurs massés devant les cages, ni de pressing collectif sur le porteur du ballon. La défense, c’est l’affaire de cinq hommes, les deux arrières, qui jouent en échelle, mais reculent pour protéger le but, plus le demi-centre. Sur les clichés de but, on voit la plupart du temps ces trois défenseurs dans l’axe, renforcés à l’occasion par les demis-aile, qui se rabattent, comme les ailiers adverses. Mais les cinq avants, eux, ne se replient pas souvent, même si cela se pratique après 1910, pour au moins un des « inters ». Les espaces, donc ne manquent pas, et cela explique les scores élevés, d’autant plus que les demis anglais, eux, ont pour habitude de monter et d’appuyer leur attaque.
« Pas question de charger le joueur adverse avant qu’il ait reçu le ballon »
En clair, les Anglais attaquent à… huit, quand, en 1906 ou 1908, les Français défendent à cinq derrière ! Comment s’étonner alors que les scores enflent ? Il est certes admis, et même recommandé, que les attaquants défendent… mais dans le camp adverse, ou dans la zone médiane, en interceptant les passes de relance, en faisant barrage, et c’est tout. Pas de tactique défensive : une équipe se sachant plus faible, comme l’équipe de France, va jouer l’offensive en 2-3-5, exactement comme celle d’Angleterre ou du Danemark ; elle ne marquera pas spécifiquement les stars adverses, n’adaptera pas son dispositif tactique.
D’ailleurs, le marquage, qui existe en théorie, se fait… à distance. Pas question de charger le joueur adverse avant qu’il ait reçu le ballon, de façon à l’empêcher d’en prendre possession ; marquer signifie se positionner afin d’intercepter, ou gêner la course de l’adversaire en reculant, et non en avançant, comme aujourd’hui. Les tacles, les charges à l’épaule ne se produisent que dans la surface de réparation. Entre les deux surfaces, le jeu est donc plus propre qu’aujourd’hui, peu de duels, pas de pressing, essentiellement des interceptions.
Le jeu de l’équipe n’est pas quasi-automatisé par les séances de répétition à l’entraînement, il est improvisé, de sorte que la moitié au moins des passes vont à l’adversaire. Les Anglais, eux, procèdent par passes courtes et se démarquent pour les recevoir, exactement comme cela se pratique aujourd’hui, ils ont donc peu de déchet, mais ce type de jeu est inconnu dans les clubs français, qui n’ont pas plus de centre de formation , ou d’école de football, que de coach. Pas totalement inconnu, puisque les Français voient évoluer les Anglais, qu’ils considèrent comme des modèles : mais de là à parvenir à les imiter…
Et la préparation athlétique ? Peut-on dire qu’aujourd’hui, même entre des sélections de niveaux aussi différents que Gibraltar et la France, les capacités athlétiques des joueurs se sont rapprochées ? Etait-ce différent il y a 110 ans ?
Le manque de souffle est une des causes majeures des grandes défaites françaises d’avant 1914, et même, comme l’a souligné dans ses mémoires Gaston Barreau (ex-capitaine, puis sélectionneur des Bleus) d’avant le professionnalisme, dans les années 1920. Par exemple, en 1906, les Bleus, menés 0-6 à la mi-temps, concèdent 9 buts ensuite ; contre le Danemark, 11 buts s’ajoutent aux 6 concédés en première mi-temps ; le découragement, certes, y avait part, comme dit plus haut, mais l’épuisement aussi. Car on ne s’entraînait pour ainsi dire pas, en France, avant 1932 !
« Certains joueurs pratiquaient de la gymnastique, ou du cross-country »
Chaque joueur était responsable de sa forme physique… ou de sa méforme. Certains pratiquaient de la gymnastique, ou du cross-country, beaucoup, de l’athlétisme en été, en guise de préparation foncière : des joueurs comme Ducret ou Dubly en ont clairement revendiqué les bénéfices. Mais pour bien d’autres, la partie du dimanche, éventuellement une partie dite d’entraînement en milieu de semaine, tenaient lieu de préparation physique.

-
L’Auto du 18 mars 1912 (BNF, Gallica)
Les Anglais, eux, avaient l’habitude prise à l’école, dans les « public schools », de l’exercice physique, bien davantage qu’en France, et leur souffle était bien meilleur : ils « tenaient » les 90 minutes. Certains clubs français, comme le Red Star, avaient fini par se doter de préparateurs : en 1914, on peut prendre connaissance du programme dans des revues comme La Vie au Grand Air : il est assez léger, essentiellement à base de sprints et de footings, mais c’était déjà un progrès !
Aujourd’hui, on sait qu’un joueur parcourt environ 10 km par match, dont 8 à 900 m à haute intensité et 3 à 400 m au sprint ; on ne dispose évidemment pas de telles données pour les joueurs d’avant 1914 ! Mais il est évident que le rythme n’était pas le même, l’intensité non plus, et qu’on courait deux à trois fois moins… Il faut dire que les joueurs étaient amateurs, plus ou moins, et de moins en moins vers 1930, et n’avaient pas autant de temps libre à consacrer à l’entretien de leur forme physique qu’un pro de nos jours.
Un match de football de haut niveau est devenu une performance athlétique, c’est incontestable, et cela depuis les années 1970, qui ont vu fleurir les tests de Cooper, ancêtres des VMA… Il ne subsiste quasiment plus de différences de forme physique entre les équipes professionnelles ; elles sont toutes préparées de la même façon, ce qui n’était absolument pas le cas avant 1914. Tout dépend après, aujourd’hui, du potentiel des joueurs, et c’est sans doute là que, pour Gibraltar, le bât blesse !
Les stades étaient eux-mêmes souvent sommaires, ouverts aux quatre vents et ne rassemblaient que quelques centaines de spectateurs. La médiatisation a aussi radicalement changé. Toi qui fais des recherches très poussées dans les journaux d’époque, peux-tu expliquer comment un match était relaté dans la presse ?
Il y a trois sortes de pressions qui peuvent peser sur l’équipe de France : celle du public, celle de la presse, et enfin celle de la fédération. Le public d’avant 1914 n’avait rien à voir avec celui d’aujourd’hui, d’autant qu’il se limitait à celui du stade. Quelques centaines, voire quelques milliers de spectateurs : 2032 pour voir la Hongrie en 1911, 4812 pour voir la Belgique en 1914. Habitué aux défaites et fair-play, le public ne siffle pas, même en cas de défaite 0-15 ! Il a intégré que le football français est dans l’enfance, encore faible. Pas de violence dans les tribunes, ni d’insultes : l’éducation qu’on recevait alors (et encore longtemps après !) condamnait les « gros mots », jugés vulgaires. Cela étonnera sans doute les lecteurs les plus jeunes, mais toute la palette des injures grossières qu’on entend à longueur de match était proscrite. On exprimait sa réprobation en y mettant les formes ! Corollaire, l’équipe de France a longtemps manqué de soutien, et de supporters, et n’a commencé à soulever de la passion qu’au cours de la Coupe du monde 1958.
La presse sportive existait, l’ancêtre de L’Equipe s’appelait L’Auto, et date de 1900. Les matchs des Bleus y étaient relatés, mais pas sur 4 à 6 pages comme c’est le cas aujourd’hui : un seul article, et jamais en première page. Les journalistes (Robert Desmarets était le grand spécialiste du football dit association) ne créaient pas de polémiques : même lorsque l’USFSA a démissionné de la FIFA, on chercherait en vain des critiques.
« A l’extérieur, des comptes-rendus réduits, qu’il faut en général attendre deux jours »
La seule fois où les sélectionneurs (au pluriel, pas question de les viser nommément, et d’ailleurs, pour connaître leurs noms, il a fallu dépouiller les bulletins officiels des fédérations) ont été critiqués, c’est en 1913, au moment où l’USFSA rejoignait le CFI, mettant fin à la querelle qui les opposait. Cette critique portait sur la désignation de deux joueurs, attribuée à la « cuisine » du comité de sélection.
Quand les matchs se jouaient à l’extérieur, pas question de missionner un envoyé spécial, d’où des comptes-rendus réduits, qu’il faut en général attendre deux jours ; les données statistiques, buteurs, minutes des buts, sont rarement fournies, et il faut, pour les établir, éplucher les annuaires étrangers bien plus complets que ceux qu’on ne trouve même plus en France.
Quant aux photos, elles existaient : la preuve, c’est que les articles consacrés aux Premiers Bleus dans comportent toujours des photos d’époque, qui ont été archivées et que l’on trouve sur Gallica. Sauf qu’avant que Gallica ne les numérise et les mette en ligne, il y a une poignée d’années seulement, il était difficile d’en trouver. Les journaux n’en publiaient guère, car la qualité de reproduction faisait défaut, sauf sur des magazines imprimés sur papier glacé comme La Vie au Grand Air, ou le Sport Universel Illustré (on y trouve, pour les amateurs, des photos du match USFSA-Upton Park validé pour les Jeux Olympiques de 1900, une rareté). Donc, la plupart des amateurs de football ignoraient le visage des internationaux, sauf ceux des clubs dont ils allaient voir les matchs, au stade : pas de star-system, à l’époque !
Quant aux fédérations, elles n’exerçaient alors aucune pression particulière, ni sur les joueurs, qui étaient libres de refuser une sélection (parce qu’on comprenait que leurs occupations professionnelles, à une époque où le seul jour de congé était le dimanche, et où l’on travaillait dix heures par jour, ne leur permettaient pas forcément de se libérer, surtout pour un match à l’étranger nécessitant un long déplacement en train), ni sur l’équipe (personne n’a imaginé sanctionner ceux qui ont perdu 1-17 face aux Danois en 1908), et encore moins sur les sélectionneurs, qui n’entraînaient pas, ne s’occupaient pas de tactique ; ils choisissaient des joueurs, les accompagnaient, et c’était tout. Gagner, tant mieux, perdre ? Tant pis ! Il n’y avait pas d’enjeu. Les matchs internationaux étaient amicaux, sur la base de la réciprocité (une fois à Paris, l’autre à l’étranger) ; la seule compétition existante, les Jeux olympiques, ne suscitait aucun battage médiatique : s’abstenir d’y participer, comme en 1912, n’a pas suscité la moindre critique dans les journaux.
« Dans le système actuel, Gaston Barreau aurait été viré au bout de quatre années maximum ! »
Les choses ont changé en 1924, parce que Paris organisait les Jeux, et le tournoi de football, où les Uruguayens ont sidéré les observateurs par leur virtuosité, a créé de la passion, laquelle est retombée ensuite. Il faut bien comprendre que deux facteurs ont contribué à faire du football ce qu’il est devenu aujourd’hui : la télévision d’abord (surtout à partir de 1966 – la première des 16 phases finales que j’ai vues, en noir et blanc, évidemment), et notamment par satellite (qui a permis la diffusion de la Coupe du monde 1970, alors que celle de 1962, au Chili, n’a pas été diffusée en Europe), et l’argent récupéré par le sponsoring publicitaire et les droits de diffusion TV, redistribués par la FIFA.
Cette manne financière sous condition (plus on va loin dans la Coupe du monde, plus on touche d’argent…) a poussé les fédérations, la FFF y compris, à professionnaliser la fonction de sélectionneur, avec obligation de résultat. Jusqu’en 1964, les sélectionneurs des Bleus étaient des bénévoles : c’est parce que la FFF se refusait à envisager de payer la fonction qu’un Gaston Barreau a pu se maintenir 38 ans dans un comité de sélection, à géométrie variable, en dépit de défaites cuisantes, et d’échecs répétés en Coupe du monde. Dans le système actuel, il aurait été viré au bout de 4 années maximum !
Du coup, pression maximale aujourd’hui, inexistante autrefois, mais…résultats lamentables autrefois, brillants aujourd’hui. La pression a du bon…
Pour finir, une mise en perspective : peut-on affirmer sans grand risque que ce 14-0 ne sera probablement jamais dépassé ni même égalé par l’équipe de France, tant la barre a été placée haute, ou, compte-tenu du nombre d’occasions créées, les Bleus pourraient faire mieux, par exemple contre Saint-Marin, dans l’avenir ?
Les scores à deux chiffres sont devenus assez rares actuellement : l’Allemagne avait battu Saint-Marin 13-0 en 2006, seule occurrence d’un tel score au 21e siècle, du moins en Europe, car l’Australie détient un record qui n’est pas près d’être approché : 31-0 face aux Samoa en 2001 ! Il existe encore des écarts de niveau abyssaux, à la FIFA… Mais Gibraltar, s’il est incapable de marquer un but en phase qualificative à l’Euro, ne prend pas dix buts à chaque fois ; en général, cinq ou six. Donc, 14-0 c’est exceptionnel, sans être un record.
Avant 1914, pour dissiper des préjugés, les scores à deux chiffres n’étaient pas non plus monnaie courante : la France étant un cas, car sur les 12 occurrences recensées, elle est concernée pas moins de 4 fois ! 0-15, 0-12, 0-11 et 1-10, entre 1906 et 1910 face à l’Angleterre amateur, et 1-17 face au Danemark. Ce qui prouve, par comparaison, le niveau incroyablement faible du football français à cette époque : la France valait, peu ou prou, le Gibraltar d’aujourd’hui…
La Russie (tsariste) suit, avec deux occurrences lors des Jeux olympiques de 1912 (0-16 et 0-12 face à l’Allemagne et à la Hongrie) mais elle n’a dû disputer que 4 ou 5 matchs avant 1914 contre 36 à la France. Restent la Norvège en 1908 (3-11) face à la Suède, et l’Autriche, mais face à l’équipe professionnelle d’Angleterre, et non l’équipe amateur, en 1908 (1-11) : des accidents. En Amérique du Sud, où le niveau était moins hétérogène, de tels scores sont restés longtemps inconnus (l’Equateur a pris 12 buts de l’Argentine en 1942) et ne se voient toujours pas aujourd’hui : le dernier cas recensé est celui du Venezuela, battu 0-11 par l’Argentine en 1975, c’est accidentel, là aussi.