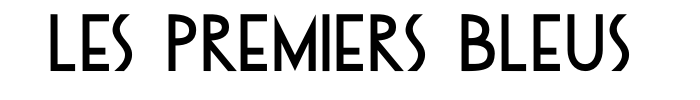Lire l’article Sélectionneurs des Bleus : ruptures et héritages
S’il y a eu un grand nombre de livres sur les sélectionneurs de l’équipe de France, celui-là est le premier à les regrouper tous, même avant la mise en place du sélectionneur unique en 1964, et même avant le premier match officiel en 1904. Qu’apporte ce travail à la compréhension du rôle ?
Tout d’abord, je tiens à souligner que ce livre est sans précédent ; certains sélectionneurs se sont racontés (Kovacs, Jacquet, Domenech par exemple) ou ont été racontés (notamment Deschamps, abondamment) ; mais il n’existait pas d’histoire complète depuis l’origine de la fonction. Bien sûr, je n’ai pas de révélations à faire sur la période dite « moderne » (commençant avec Michel Hidalgo), la mieux couverte par les récits dont je viens de parler ; par contre, il y a je crois, tout à apprendre au public concernant la période la plus ancienne, celle d’avant 1914, et même avant 1945, voire 1960.
La leçon qu’on peut tirer de la lecture des 32 chapitres du livre, c’est que les sélectionneurs n’ont pas tous eu le même profil, ni disposé des mêmes moyens. Ce n’est pas la même chose, en 1914 par exemple, de s’occuper d’amateurs sélectionnés au terme d’un affrontement parmi les membres du comité de sélection, arrivant exténués en train la veille au soir du match, alignés sur le terrain de jeu sans aucun travail tactique en commun ni préparation d’aucune sorte, pour les laisser improviser face à un adversaire dont chacun ignore tout, et en 2020 de rassembler après un trajet en avion des pros reposés, dûment formés à toutes les tactiques, observés sous toutes les coutures avant de les choisir, pour les préparer à un match par une séance d’analyse vidéo adaptée !
Les sélectionneurs de 1914 étaient des bénévoles sans aucune formation ni expérience d’entraîneur (et cela dura jusqu’en 1964 !), ceux d’aujourd’hui sont des professionnels diplômés, ayant fait leurs preuves dans des clubs de haut niveau : faut-il s’étonner que les derniers soient plus performants que les premiers ?
Mon ambition, à travers ce livre, est d’aider le lecteur à comprendre que le rôle de sélectionneur a profondément évolué, dans quelles directions il a évolué par paliers, et en quoi ces évolutions successives ont pu permettre à l’équipe de France de sortir de la médiocrité où elle a longtemps stagné.
Ton précédent ouvrage, L’intégrale de l’équipe de France (1904-1998), faisait déjà la part belle aux sélectionneurs et à leurs choix. Cet ouvrage est-il en quelque sorte un approfondissement ?
L’Intégrale de 1998, version narrativisée de celle purement statistique de 1992, était une analyse match par match qui faisait à mon sens la part plus belle aux joueurs qu’aux sélectionneurs. Dans Sélectionneurs des Bleus, le parcours de chacun des sélectionneurs n’est pas analysé match par match mais synthétisé, et la conclusion ajoute encore une autre synthèse, plus globale. Les démarches sont donc différentes.
Dans l’introduction, je recours à l’image de l’iceberg : les 10% visibles, c’est le match des joueurs ; et les 90% invisibles, c’est le travail en amont du sélectionneur. Alors oui, il y a un approfondissement. Depuis 1998, j’ai pris davantage conscience de l’importance du rôle du sélectionneur ; et pour reprendre mon image de l’iceberg, je dirai qu’avant, j’estimais sa contribution aux résultats à 50%. On voit la différence !
« Ce n’est du reste pas pour rien que, quand les résultats ne sont pas satisfaisants c’est l’entraîneur qui saute, même les plus grands, et pas les joueurs. »
Je ne suis pas le seul à avoir mieux pris conscience de l’importance de son travail. A lire la presse, Manchester City c’est Guardiola. Liverpool ? Klopp, et ainsi de suite. Ce n’est du reste pas pour rien que, quand les résultats ne sont pas satisfaisants c’est l’entraîneur qui saute, même les plus grands, et pas les joueurs. André Villas-Boas a récemment déclaré : « Si mes joueurs ne sont pas capables d’être au top niveau, c’est moi le responsable ». Ce raisonnement est applicable aux sélectionneurs, qui sont assimilables aux entraîneurs de club.
Donc j’explique, chapitre par chapitre, en quoi chacun des 32 sélectionneurs est responsable des réussites ou des échecs des Bleus sur 120 ans avec des circonstances atténuantes... ou pas, dans le second cas. Mais il y a bien effectivement une parenté entre les trois ouvrages de 1992, 1998 et 2020 : ils se complètent, en fait.
Peut-on dire qu’il y a eu plus de ruptures que de continuité entre les différents sélectionneurs ? Pourquoi ?
La continuité est incarnée par l’inamovible Gaston Barreau, 38 années à la barre ! On peut aussi dire que Michel Hidalgo, intronisé par Stefan Kovacs, dont il était l’adjoint, intronisant à son tour Henri Michel, a tenté d’instaurer une certaine continuité, celle de la DTN, qui a encore pu placer Raymond Domenech en 2004. Mais le double fiasco de Lemerre en 2002 et de Domenech en 2010 y a mis fin. Alors oui, il y a davantage de ruptures que de continuité pour cette fonction chahutée.
La formule du comité de sélection, créé en 1909, a montré ses limites à l’usage : inflation, politique de compromis. Elle a cédé la place en 1936 à celle du « sélectionneur unique », qui n’était en réalité pas si unique que ça, et une querelle de personnes (Nicolas-Hanot) a suffi à la renverser et à ressusciter celle du comité, mais flanqué d’entraîneurs changeant au gré des humeurs, bref c’était la pagaille ! La FFF ne s’est décidée à en sortir qu’en 1964 en optant pour une troisième formule, celle du « sélectionneur-entraîneur » professionnel, dont la continuité semble désormais assurée.
« La condition sine qua non pour durer, c’est de réussir et de plaire. »
Mais, à l’instar de l’entraîneur de club qu’il est devenu au fil des années, le sélectionneur est désormais assis sur un siège éjectable. Rien de nouveau sous le soleil : à l’époque lointaine où le Bureau Fédéral désignait chaque année le comité de sélection, qu’il reconduisait ou amendait, on voyait disparaître certains noms et en apparaître d’autres, sans commentaires ni récriminations. La différence depuis 1964 et la fin du bénévolat, si discret et si pratique pour la FFF, c’est que les limogeages font du bruit, et vont parfois même jusqu’au contentieux...
La condition sine qua non pour durer, c’est de réussir (pour la FFF) et de plaire (pour la presse). Que signifie réussir ? En pratique, c’est ne pas décevoir : les objectifs ont varié, en 60 ans. Aujourd’hui, les Bleus doivent gagner des trophées parce qu’ils l’ont déjà fait, le curseur de l’exigence est placé haut. Dans le passé, quand l’équipe de France peinait à simplement se qualifier pour la phase finale des compétitions, ne pas décevoir se limitait à se qualifier. Mais il faut aussi plaire, il y a une exigence forte touchant la qualité du jeu (le « football-champagne » !).
L’idéal est donc d’allier les deux mais à défaut gagner suffit à conserver son poste, pas à s’épargner les critiques de la presse, qui est un acteur déterminant dans le vie des sélectionneurs.
Force est de constater que beaucoup de sélectionneurs souffrent, c’est une forme de continuité, même les gagnants, et je ne crois pas que depuis Hidalgo, un seul de ses 8 successeurs ait bien vécu son expérience à la tête des Bleus... hormis Didier Deschamps, qui a ramené la sérénité. C’est pourquoi il dure, et va durer plus longtemps que ses prédécesseurs...
Dans ton livre, tu t’attaches à décrire précisément où commence et où s’arrête le rôle du sélectionneur. A quel moment devient-il moderne, au sens où on le conçoit aujourd’hui ?
Je fais en effet allusion en conclusion à la Querelle des Anciens et des Modernes, qui opposait à la fin du 17ème siècle les tenants de la littérature de l’Antiquité gréco-latine à ceux de la littérature contemporaine.
En matière de football il n’y a pas photo : jusqu’en 1984 l’équipe de France a cumulé les échecs, sauf ponctuellement, alors que depuis elle a accumulé 7 trophées ! La césure entre les Anciens et les Modernes, dans ce sens, se situe donc dans les années 80 , et Michel Hidalgo peut être alors qualifié de premier sélectionneur moderne...
« la modernité a commencé dès qu’on a cessé d’improviser sur un terrain, c’est-à-dire en 1934 en France. »
Les trophées ne viennent pas par hasard, ne tombent pas de l’arbre comme des fruits mûrs : il faut les conquérir. Et pour cela, il faut d’abord le vouloir. L’Euro 1984 a été la première compétition qu’un sélectionneur des Bleus ait voulu conquérir, parce qu’il était le premier qu’il jugeait pouvoir conquérir. L’équation à résoudre pour y parvenir (selon la formule de Jean-Louis Gasset que je cite en introduction) comporte différentes variables. Les unes sont anciennes ou si l’on préfère, traditionnelles : talent des joueurs, condition physique, expérience, détermination collective. Les autres sont modernes et tiennent à la tactique : WM (1934), milieu à 4 avec 3 « numéros 10 » (1982), « arbre de Noël » à 3 milieux défensifs derrière deux créatifs (1998), etc...
On le voit, la modernité a commencé dès qu’on a cessé d’improviser sur un terrain, c’est-à-dire en 1934 en France ; mais elle n’a guère porté de fruits tant que les sélectionneurs ont eu du mal à s’y adapter, et à la maîtriser. Si les trophées sont enfin venus, c’est au contraire parce qu’ils y sont parvenus. Aujourd’hui, les variables modernes ont encore évolué : ce sont la possession, le pressing haut ou bas, le changement de système en cours de match.
Tous les sélectionneurs, après que Michel Hidalgo a ouvert la voie et démontré que c’était possible, ont ambitionné de gagner l’Euro et la Coupe du Monde ; tous n’y sont pas parvenus, loin de là, mais tous en ont rêvé, alors qu’avant aucun ne l’imaginait, même en rêve !
Finalement, c’est cela, la différence entre les Anciens et les Modernes, chez les Bleus...
On parle beaucoup moins d’eux car ils sont dans l’ombre du sélectionneur, mais les adjoints ont eu aussi leur importance dans l’histoire des Bleus. Lesquels ont été les plus marquants pour toi ?
Depuis 1967 (mais déjà aussi ponctuellement à l’occasion de la Coupe du monde 1966), les sélectionneurs bénéficient des services d’un adjoint permanent. Peut-on comparer la relation qu’ils entretiennent avec celle existant entre les membres d’un comité de sélection ? Non, la différence venant du rapport hiérarchique : l’adjoint n’a qu’une voix consultative, et encore, facultative, si le sélectionneur sollicite son avis sur le choix de tel ou tel joueur et de telle ou telle tactique.
Même si au sein des comités de sélection du passé l’égalité n’était que théorique, et que dans les faits une personnalité ait toujours été dominante, les rapports ne sont nullement les mêmes. Ils se rapprochent plutôt des rapports existant entre les comités et les entraîneurs qui leur furent adjoints, entre 1920 et 1964.
« Les adjoints qui ne sont pas sortis de l’ombre les plus marquants sont à mon avis Marc Bourrier et Jean-Louis Gasset. »
L’adjoint moderne est chargé d’appliquer le programme d’entraînement élaboré par le sélectionneur, il véhicule les consignes, crée du lien, et répercute en les filtrant les avis et les émotions des joueurs. Il apporte ainsi un éclairage supplémentaire au sélectionneur.
Il existe deux catégories d’adjoints : ceux qui ont pris la relève de leurs sélectionneurs, par accident ou par recommandation de ces derniers : Houllier, Jacquet dans le premier cas, Hidalgo, Michel, Lemerre dans le second. Le livre leur consacre un chapitre à part entière, je n’en parlerai donc pas ici. Et les autres, qui ne sont pas sortis de l’ombre, pour une raison ou une autre. Les plus marquants sont à mon avis Marc Bourrier et Jean-Louis Gasset.
Bourrier, parce qu’il fut le prototype de l’adjoint à l’écoute, apprécié des joueurs pour ses qualités humaines. Hidalgo lui préféra Henri Michel pour lui succéder, mais Bourrier se vit confier les Espoirs, et démontra ses capacités, puisqu’il gagna le Championnat d’Europe 1988. Gasset, actuel entraîneur de Bordeaux, parce qu’avec Laurent Blanc ils s’étaient partagés les tâches d’une façon originale : Blanc demeurait distancié par rapport aux joueurs, et Gasset était, dixit Adil Rami, « l’aboyeur » sur le terrain, plus paternaliste. Sélectionneur et adjoint étaient ainsi parfaitement complémentaires.
- Lire l’interview Guy Stéphan : « l’adjoint est un réducteur d’incertitudes »
Tu expliques que chaque sélectionneur connaît un parcours fait de trajectoires ascendantes et descendantes. La différence se fait-elle entre ceux qui partent au bon moment, après un succès (Hidalgo, Jacquet) et ceux qui restent jusqu’à l’échec (Platini, Lemerre, Domenech) ?
On peut distinguer 4 types de parcours de sélectionneurs différents : linéaire (dans la médiocrité !), en dents de scie (victoires et défaites alternant sans logique), ascendant puis descendant, la chute étant due à un seul match parfois, goutte d’eau faisant déborder le vase, mais le plus souvent à une compétition ratée, et enfin le plus rare, ascendant. Ce dernier profil, le plus prestigieux, ne concerne que Paul Nicolas, Michel Hidalgo, Aimé Jacquet et pour le moment Didier Deschamps.
Comment ont-ils évité la chute, lot commun de la plupart ? On observera d’abord que leur parcours est long : 10 ans pour Nicolas, 8 (plus 4 d’adjoint) pour Hidalgo, 4 (plus 2 d’adjoint) pour Jacquet, déjà 8, et 10 de prévus pour Deschamps. Tous ont pris les Bleus au fond du trou, ou peu s’en faut, tous les ont amenés à un trophée, ou un accessit (Nicolas) : le livre explique comment, je n’y reviens pas ici.
« La vraie différence entre les sélectionneurs se situe entre ceux qui ont choisi de s’arrêter et ceux qui l’ont subi. »
Ont-ils su partir au bon moment, avant que la situation ne se gâte ? Nicolas est mort en fonction ; Hidalgo avait anticipé son départ dès 1981, soit 3 années avant le succès à l’Euro, et Jacquet annoncé son départ en 1997 : donc non, ils n’ont pas calculé, et le succès ne les a pas fait revenir sur leur décision. Quant à Deschamps, son contrat court jusqu’à la fin de l’année 2022, et le succès de 2018 ne lui a pas donné envie d’arrêter, au contraire.
En fait, la vraie différence entre les sélectionneurs se situe entre ceux qui ont choisi de s’arrêter et ceux qui l’ont subi, « remerciés », licenciés ou poussés dehors, toujours pour cause d’insuffisance de performances bien sûr. J’excepte ceux d’avant 1919, leur cas est très différent, trop complexe pour l’exposer ici en quelques lignes.
Enfin, parmi ceux qui ont choisi, il faut distinguer entre ceux qui sont partis après un succès, en pleine gloire donc, et ceux dont l’image a été plus ou moins écornée par un échec mais qui sont partis pour d’autres raisons : voir, dans le livre, celles qui ont causé le départ de Dugauguez, Platini, Santini ou encore Blanc.
Quant à Didier Deschamps, son profil est inédit : il est arrivé au sommet après 6 années d’ascension, et il lui en reste encore deux, jalonnées de trois compétitions (Euro, Ligue des Nations, Coupe du Monde), avec la perspective de se maintenir en « plateau » au sommet, ce qui inaugurerait un cinquième type de parcours, qu’on lui souhaite bien évidemment de réaliser ! Mais quoi qu’il arrive, il sera de ceux qui auront choisi leur sortie.
Dans une précédente interview, tu disais que tu suivais les Bleus depuis 1962, soit à la fin de l’ère Batteux. Tu as donc vécu près de 600 matchs de l’équipe de France. En quoi tes souvenirs ou impressions personnelles entrent en jeu dans ton livre, par rapport à la période antérieure ?
C’est en effet en 1962 que j’ai vu à la télévision bien sûr, mon premier match des Bleus, qu’on appelait alors les Tricolores. Tout de suite je me suis attaché et identifié à cette équipe en dépit de ses mauvaises performances récurrentes, davantage qu’à celle de ma ville, Lyon. Peut-être parce que, d’ascendance corrézienne et lorraine, j’étais un produit du melting-pot hexagonal !
Je me souviens parfaitement de la détestation suscitée par Georges Verriest, qui n’a eu d’égale, par la suite, qu’avec celle pour Georges Boulogne et Raymond Domenech (quoique ce dernier, étant lyonnais, bénéficiait pour moi d’une certaine indulgence...). Mais je n’avais pas conscience que Verriest subissait le déficit athlétique du football français ; je croyais juste qu’il était mauvais, et ne choisissait pas les bons joueurs ! Je n’en ai pris conscience que des années plus tard.
« Le souvenir se bloque sur les péripéties d’un match mais ne permet pas d’évaluer le travail d’un sélectionneur. »
C’est donc une arme à double tranchant que d’avoir vu les matches, et je n’en ai pas raté beaucoup depuis 1962 ! En effet, le souvenir nous laisse surtout des émotions. Je me souviens de ma rage à voir les Français buter en 1968 sur un gardien norvégien en état de grâce ; et que dire du tir de Kostadinov en 1993 ! Le souvenir se bloque sur les péripéties d’un match mais ne permet pas d’évaluer le travail d’un sélectionneur ; on lui en veut en cas de défaite, car il est dans le même bain que les joueurs, c’est tout.
L’avantage, quand on s’occupe des matches très anciens, ceux d’avant 1914, 1940, voire 1960, c’est qu’on travaille sur des documents écrits, des images d’archives, de façon analytique, sans passion, avec le recul : l’analyse permet de distinguer aisément ce qui a trait aux joueurs et ce qui concerne le sélectionneur, dans les victoires et dans les défaites.
Heureusement, ce recul s’installe aussi par rapport aux matches postérieurs à 1962 : il permet de relativiser les souvenirs, de se faire une opinion bien plus rationnelle. Par exemple, j’ai aujourd’hui une vision plus positive de Georges Boulogne qu’à l’époque, j’ai pris conscience qu’il a remis le football français dans le sens de la marche.
Bien entendu, plus le passé est proche, plus cette distance indispensable à l’analyse est difficile à instaurer. Je pense à Knysna, notamment, même si dix années commencent à dépassionner l’évènement. Et que dire de l’actualité de 2020, qu’il faut bien traiter ? Sinon laisser s’exprimer le supporter des Bleus, et souhaiter à Deschamps et à son équipe tous les succès possibles ?
En conclusion, tu poses une question importante : dans quelle mesure les sélectionneurs sont-ils responsables de la réussite ou de l’échec des équipes qu’ils choisissent et dirigent ?
J’estime la part du sélectionneur entre 50 et 90% du résultat, selon les circonstances atténuantes qu’on peut lui attribuer, telles que je les ai listées dans ma conclusion, et auxquelles j’ajouterais celle inhérente aux « faits de jeu ».
Si Zidane donne un coup de tête à Materazzi et se fait expulser, par exemple, si Trezeguet expédie son tir au but sur la barre, lors de la finale de la Coupe du monde 2006, ce sont des faits de jeu, qui ne sont pas imputables à Raymond Domenech. Par contre, le tir de Kostadinov en 1993, qui scelle l’élimination de la Coupe du monde, n’est pas un fait de jeu. Il révèle une carence défensive déjà observée au match précédent, contre Israël, que Gérard Houllier aurait pu et dû prévoir et corriger.
« La préparation mentale, ce sont des mots, c’est une énergie communiquée à un groupe. »
Le plus brillant sélectionneur du monde, s’il ne dispose pas, sinon de joueurs de haut niveau, du moins des joueurs capables de compenser leur déficit par un engagement sans faille, ne fera jamais que de la figuration : ce fut le cas de Kovacs, venu auréolé de trophées décrochés avec l’Ajax d’Amsterdam. Donc il faut que la mayonnaise prenne : et pour cela, il y faut, outre les bons ingrédients à la bonne température, le tour de main !
Les ingrédients, ce sont les joueurs (de plus ou moins grand talent, cela ne dépend pas du sélectionneur), la température, leur état d’esprit (conquérant ou pas, et cela dépend du sélectionneur), et le tour de main la patte du sélectionneur, à savoir, outre la tactique et son animation : la préparation mentale. Qu’est-ce que c’est ? Ce sont des mots, c’est une énergie communiquée à un groupe. Helenio Herrera a été le premier à comprendre l’importance des slogans, d’une forme de conditionnement emprunté quelque part à la méthode... Coué !
Trouver les bons mots permet de sublimer une équipe ; galvaniser un groupe, c’est trouver les bons ressorts, insuffler une énergie positive, à ne pas confondre avec pousser un coup de gueule ! Tous n’en sont pas capables, cela dépend du charisme personnel. Le spectateur a l’impression que les grands joueurs, les Kopa, Platini ou Zidane font tout ? Mais c’est oublier que même les grands joueurs ont besoin de mots pour donner le meilleur d’eux-mêmes, et des directives du « coach » pour guider leur action.
Le temps où onze joueurs improvisaient au gré de leur inspiration, en tâchant de combiner au petit bonheur la chance, sous l’influence des plus doués et des plus dominants, est depuis longtemps révolu. Depuis quand, au juste ? Je laisserai le lecteur le découvrir à travers les chapitres du livre !
Mais incontestablement l’importance du travail du sélectionneur, qui se limitait originellement à sélectionner, n’a fait que croître au cours des années.
Fortement concurrencées par des clubs surpuissants et des compétitions de plus en plus élitistes, les sélections nationales ont-elles un avenir dans le football du 21ème siècle ?
Historiquement, les clubs ont toujours été plus ou moins ouvertement hostiles à l’équipe de France ; ils n’aimaient pas mettre leurs joueurs à sa disposition , par peur des blessures. Dès sa formation en 1944 , le GCA (ancêtre de la Ligue) a posé ses conditions, cherché plus d’une fois à s’approprier l’équipe de France, et mis des bâtons dans les roues de plus d’un sélectionneur !
Aujourd’hui, l’intérêt des clubs converge avec celui de la FFF, car les joueurs prennent de la valeur quand ils sont internationaux, le trading est tout ! De plus les clubs français ne sont pas surpuissants, à l’exception du PSG, leur niveau est même faible, ce qui se vérifie en C1 ou en Liga Europa. Le public n’aime pas les perdants, le PSG n’est pas populaire, et quant aux clubs populaires, comme les Verts ou l’OM, ils vivent sur leur passé, qui s’éloigne de plus en plus !
« Le football de sélection est et restera un cran au dessus du football de club, tout au moins chez nous. »
L’équipe de France au contraire est gagnante, elle apparait depuis plus de 20 ans comme capable de remporter toutes les compétitions, et même quand elle n’y parvient pas, elle suscite un engouement constant. Les internationaux, recrutés par des clubs étrangers surpuissants comme le Real, le Barça, Manchester United ou le Bayern, garnissent certes leur compte en banque et étoffent leur palmarès ; mais est-ce que la récente victoire du Bayern en C1 a permis aux quatre « Bleus en rouge » du club allemand de gagner le coeur des supporters français ? Non, rien ne dépasse émotionnellement le maillot bleu, qui rassemble tous les joueurs français désormais éparpillés aux quatre coins de l’Europe, et transcende la division née de la rivalité des clubs.
Donc je ne pense pas qu’il y ait de concurrence. Le football de sélection est et restera un cran au dessus du football de club, tout au moins chez nous.
Pour terminer, il semble évident pour beaucoup que le successeur de Didier Deschamps, probablement après la prochaine Coupe du monde, sera Zinédine Zidane. L’histoire des sélectionneurs n’incite-t-elle pas à un minimum de prudence ?
On sait que Zidane est tenté par le poste, que le contrat de Deschamps arrive à son terme fin 2022, le timing semble donc idéal pour un passage de relais entre les deux ex-champions du monde.
Ceci dit, il y a des sélectionneurs désirés, par la vox populi et la vox mediorum, et les autres... largement majoritaires, tant le poste a longtemps paru risqué et peu valorisant. Hidalgo lui-même n’a pas été désiré, sa nomination saluée de commentaires dédaigneux. Jacquet pareil, traité de « has been ». Par contre Platini a été porté par un élan médiatique le présentant comme un « sauveur », ce qu’il a été jusqu’à l’Euro 1992, où, lassé, il a laissé tomber l’équipe de France comme une vieille chaussette. Laurent Blanc aussi a été désiré et le même schéma s’est reproduit, avec des causes un peu différentes, mais le même effet : un Euro 2012 raté.
« Zidane est à Deschamps ce que Pelé est à Zagallo. »
Les grands joueurs attirent comme le miroir attire les alouettes, bien davantage que les grands entraîneurs dépourvus de palmarès de joueur : Kovacs, Herrera ou Schwartz, les deux derniers ont coaché les sélections d’Espagne et d’Italie, des Pays-Bas, jamais de France), ou même les « petits » internationaux, comme Hidalgo... ou Domenech, ce qui est injuste car les vedettes font rarement de grands « coaches ». Exemple : Maradona, immense joueur, a échoué avec l’équipe d’Argentine et a insulté la presse, ce qui n’a pas amélioré son image.
Qu’on songe, enfin, que ce n’est pas Pelé qui a gagné la Coupe du monde comme entraîneur après l’avoir gagnée comme joueur mais son plus modeste équipier Mario Zagallo.
Zidane est à Deschamps ce que Pelé est à Zagallo : néanmoins, les capacités de coach démontrées par Zidane au Real le rendent aussi légitime que crédible ; l’avenir nous dira donc si, en prenant éventuellement la succession d’un Deschamps auréolé, il réussira le défi de garder le même niveau de performance. Ce qui n’est jamais évident lorsqu’il faut démarrer un nouveau cycle.