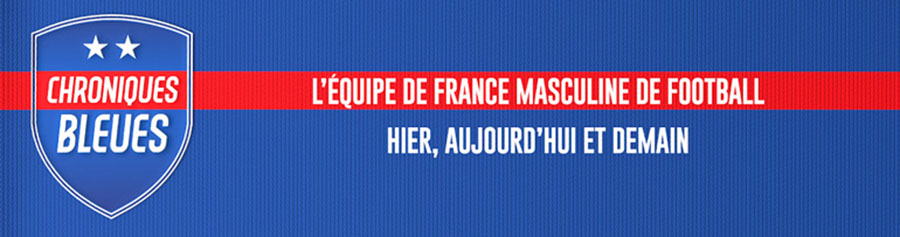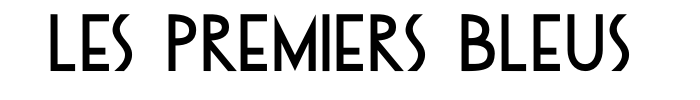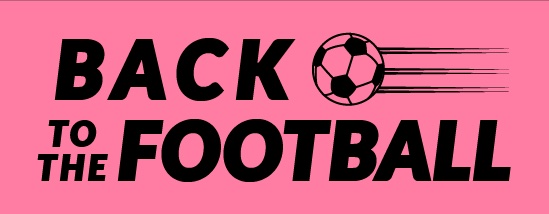Alexandre Joly, 31 ans, est professeur d’EPS et historien du sport. Il a soutenu une thèse en 2021 sur l’évolution de l’arbitrage en France entre 1955 et 1995, travail qu’il a développé en amont et en aval dans un livre publié par les Presses universitaires de Rennes, Les hommes en noir du football, histoire d’une profession de 1919 à nos jours (378 pages, 26 euros).

Qu’est-ce qui dans ton parcours, t’a amené à écrire ce livre ?
Tout d’abord, l’arbitrage. J’ai joué au foot à partir de 6 ans. En première au lycée, un copain m’a parlé de l’arbitrage et m’a dit qu’il fallait que j’essaie. Je suis devenu joueur-arbitre. Pendant 9 ans, j’ai grimpé les échelons, arbitre départemental, puis régional jusqu’en R2 au centre et N3 à la touche et quelques matchs de D1 féminine à la touche. C’est vraiment une passion pour l’arbitrage que j’ai développée sur le tard. J’ai fait deux premières années d’études en Staps à Toulouse puis j’ai été recruté sur concours à l’ENS de Rennes. Je me suis intéressé à l’histoire de l’arbitrage, j’ai fait un mémoire de Master sur le sujet, puis j’ai rencontré Vautrot à Bensançon, en 2017. Il m’a ouvert son réseau sur les anciens arbitres, et je me suis engagé dans cette thèse grâce à ça. On a une relation très proche, je vais à Besançon régulièrement, on échange des mails souvent. Quand j’étais encore arbitre, il me demandait comment ça se passait, il vivait un peu l’arbitrage d’aujourd’hui à travers moi.
« Le plus passionnant, c’est quand ils m’ont ouvert leurs archives personnelles »
Ton travail compile une masse très importante de sources documentaires et de témoignages. Comment t’es-tu organisé pour chercher des sources et des interlocuteurs ?
Le travail de l’historien est d’abord de chercher des archives institutionnelles. Or elles ont été pour l’essentiel détruites à la FFF au début des années 2000. Je me suis orienté sur la médiathèque de la FFF, avec des comptes rendus de la CCA (commission centrale des arbitres). J’ai tout lu sur la période de 1950 à 1995, ça m’a pris beaucoup de temps. J’ai couplé ça à l’étude de L’Equipe et France Football à la BNF de Paris, je me suis centré notamment sur les articles des finales de la Coupe de France avant et après. Pour France Football, j’avais beaucoup de données depuis mon mémoire de master 1 qui portait sur les représentations de l’arbitre dans l’hebdomadaire.
Avec les entretiens, j’ai pu avoir des témoignages directs, mais le plus passionnant c’est quand ils m’ont ouvert leurs archives personnelles. Robert Wurtz avait plein de carnets où il avait tout recensé, ses matchs, ses indemnités, des commentaires, des photos. Ces archives de l’intime, j’en ai eu de pas mal d’arbitres : Robert Wurtz, Michel Vautrot, Gérard Biguet…Toutes ces données m’ont permis de croiser les sources et des constituer des données fiables, solides. Et il y a aussi les archives de l’INA pour les finales de Coupe. François da Rocha Carneiro m’a envoyé son manuscrit de thèse, et j’ai beaucoup aimé ses histoires de matchs, sur le terrain. Et ça m’a donné l’idée de faire la même chose avec les arbitres, à travers le match. J’ai pu aussi interroger d’anciens joueurs (Domenech, Giresse, Passi…) pour ne pas rester dans le microcosme arbitral.
Les 43 encadrés biographiques des arbitres sont très riches, car ils permettent de mesurer les similarités et les différences entre les parcours. Comment t’y es-tu pris pour les construire ?
Dans la hiérarchie arbitrale, j’ai pu reconstituer ces carrières via France Football Officiel (l’organe de la FFF) à 95%, des données institutionnelles donc. Pour les autres données, je m’appuie sur des entretiens (via des témoignages d’autres arbitres, par exemple Michel Vautrot sur Robert Wurtz) pour éviter les surinterprétations ou les histoires trop linéaires, en oubliant les aléas. Je pense à Georges Konrath : un arbitre, je ne sais plus lequel, m’a raconté que sa femme décède au début des années 1980, et son autoritarisme déjà important va s’amplifier à partir de la mort de sa femme. Ça me semble intéressant de le mentionner.
En 1963, le commentateur disait : « lancez vos chronomètres ! »
Autre originalité, l’analyse de 4 finales de Coupe de France à partir des interventions de l’arbitre et de son comportement. On a parfois l’impression d’être sur le terrain, en caméra embarquée… Quel travail cela nécessite-t-il au visionnage du match ?
Je ne pouvais pas m’appuyer sur de l’existant puisque ça n’avait jamais été fait. Le plus dur ça a été les premières finales (celle de 1963) sans chronométrage à l’écran, il fallait que je chronomètre moi-même à la BNF. Le commentateur d’ailleurs le dit au début du match : « lancez vos chronomètres ! » (rires). Chaque finale a été vue deux fois. Je coupais lors des moments saillants : les gros plans sur lui, ses interactions avec les joueurs, les coups de sifflet, les avertissements, son aspect physique, les styles de course… j’avais une grille de lecture à chaque fois. J’ai une petite frustration pour la finale 1976 : on n’entend pas les commentaires, et c’est dommage. Ça m’a manqué. Pour chaque finale, je fais un récit du match et aussi une l’analyse de ce que j’ai vu.
Peut-on dire que l’arbitrage a évolué dans des proportions plus grandes que le jeu lui-même, ou avec des temporalités différentes ? Pourquoi ?
Il y a une évolution à la hauteur de celle du jeu, mais avec un décalage : je pense à la dimension économique. Les joueurs ont un statut pro avec un entraînement physique et tactique. Mais aussi la vitesse du jeu : en 1963 il est lent, il y a beaucoup d’erreurs techniques. L’arbitre Pierre Schwinté n’avait pas de capacités physiques extraordinaires, mais ce n’était pas nécessaire. Et puis les arbitres avaient leur métier à côté, alors que pour les joueurs c’est leur profession. Il faut qu’il y ait des choses très médiatisées pour voir la FFF changer sur l’arbitrage : tant qu’il n’y a pas de problème, il n’y a pas de moyens. Les réformes vont venir après.
Tu parles plusieurs fois dans le livre de déplacements en diagonale, puis de diagonale ondulée. Peux-tu préciser ?
C’est une manière de courir sur le terrain pour à chaque instant avoir en visibilité le ballon et ses arbitres assistants. On se déplace d’un poteau de corner au poteau de corner opposé, dans cette diagonale, pour être à chaque fois à dix mètres du ballon, un peu excentré sur un côté, et ne jamais se trouver dans une situation où on a l’assistant dans son dos. Avant c’était une diagonale stricte avec des zones où il ne fallait pas aller, alors que la diagonale ondulée introduit plus de souplesse. Par exemple, avant les arbitres avaient interdiction d’entrer dans la surface de réparation. C’était une zone qui appartenaient aux joueurs. Aujourd’hui, il entre dans la surface pour être plus proche du jeu.
« Ça m’a rappelé le panoptique de Bentham chez Michel Foucault »
Ce livre est aussi, et peut-être avant tout, un ouvrage sur la domination. Celle de l’arbitre sur les joueurs et le jeu, et celle des instances sur les arbitres, avec des rapports de force, des sanctions, des luttes d’influence… Tu cites souvent l’ouvrage de Michel Foucault, « Surveiller et punir ». En quoi t’a-t-il inspiré ?
Quand j’ai lu ses travaux, pendant ma thèse, j’ai fait beaucoup de parallèles avec les entretiens, notamment avec Jean Tricot qui a été arbitre dans les années 1960. il me disait qu’il pensait être observé pendant les matchs, mais les observateurs ne prévenaient jamais les arbitres qu’ils seraient là, ça m’a rappelé le panoptique de Bentham chez Michel Foucault : avoir l’impression d’être tout le temps surveillé, même si on ne l’est pas, c’est ça qui fait marcher le pouvoir. On peut l’appliquer à la VAR ou aux sanctions des arbitres. Pourquoi ils se soumettaient à l’institution, quand ils étaient amateurs, puisqu’il n’y avait pas d’enjeu financier ? En fait, le système d’accès à l’élite de l’arbitrage, avec une valeur symbolique, c’est ce qui faisait le pouvoir de la CCA, de normaliser le comportement des arbitres et de les sanctionner quand ils s’éloignaient de la règle.
La tendance du football moderne depuis une quarantaine d’années est de réduire la violence et de favoriser le spectacle. Dans quelle mesure cette évolution a modifié le rôle de l’arbitre ?
C’est l’impact du Board et de la FIFA, avec les évolutions des années 1990, qui va générer beaucoup d’évolution. Depuis 40 ans on est sur médiatisation du football avec le plus de continuité possible et avec le moins de violence possible. L’engagement des joueurs du terrain participe du spectacle, c’est indéniable. Mais cet engagement des joueurs ne doit pas dépasser un certain niveau, et ce niveau de violence va dépendre des périodes. C’est ce que montrent les travaux de Norbert Elias sur la pacification des moeurs. La sensibilité à la violence évolue dans le temps et en lien avec la société. Aujourd’hui, par exemple, les fautes qui génèrent systématiquement un carton rouge, dans les années 1980, c’était parfois un jaune ou rien du tout.
Tout comme l’équipe de France, les arbitres français se sont fait une place au niveau international, notamment depuis les années 1970 avec Robert Wurtz, Michel Vautrot, Joël Quiniou… Où se situe aujourd’hui l’arbitrage français dans la hiérarchie mondiale ?
Il y a eu des fluctuations à la fin des années 2000, début des années 2010, c’était une période de creux pour l’arbitrage français avec la non-sélection à la Coupe du monde 2014. Depuis cette période, l’arbitrage français n’a fait que monter. La représentation des arbitres français à l’échelle internationale est très importante, avec une très bonne réputation : François Letexier et Clément Turpin sont dans les cinq meilleures arbitres du monde actuellement. Letexier a dirigé la finale de l’Euro 2024, Turpin fait chaque année un quart, une demi ou une finale de Ligue des Champions, comme en 2019 entre le Real et Liverpool. On est dans une période très faste, même pour des articles moins connus comme Benoît Bastien ou Stéphanie Frappart, même si c’est un peu plus difficile pour elle en ce moment. C’est un nouvel âge d’or comme on a eu entre la fin des années 1970 et le début des années 1990.
« Depuis sa finale de l’Euro, François Letexier est propulsé dans une autre dimension »
C’est en partie en lien avec la professionnalisation mise en place en France à partir de 2016, mais en retard par rapport aux arbitres anglais professionnels depuis 2001. Mais il y a aussi données plus informelles, un facteur chance : François Letexier n’était pas prévu pour la finale de l’Euro l’an dernier, mais il a fait une très bonne prestation lors de Géorgie-Espagne en huitièmes et a eu une très bonne observation d’un membre important de l’UEFA. Ça se joue à peu de choses. Depuis la finale de l’Euro, François Letexier est propulsé dans une autre dimension.
Quand un arbitre français dirige un match international, il représente quoi ? La France ? Le football français ? L’arbitrage français ?
Il est d’abord la vitrine de l’arbitrage français, mais aussi de la FFF qui met en avant cette représentativité : c’est une fierté et une volonté d’avoir ses arbitres au plus haut niveau international.
L’histoire des Bleus est parsemée de conflits avec des arbitres, mais aussi de croisements avec des évolutions des règles : tirs au but en Coupe du monde, la GLT en 2014, la VAR en 2018… Là aussi, il y aurait plein de choses à raconter !
Il y a énormément de choses à raconter, j’en parle dans mon livre, notamment la manière dont Thierry Roland va apostropher Ian Foote en 1976, et qui va marquer toute une génération de Français. On pense aussi en 1982 avec Schumacher et Battiston… L’histoire du football est intimement liée à l’arbitrage. Depuis les années 1970, il y a peu de buts marqués, avec une décision arbitrale qui va souvent décider du sort du match, sur un coup de pied arrêté par exemple. Beaucoup de matchs se sont joués sur une décision arbitrale et on ne va retenir que cet aspect-là. Certains pensaient que l’introduction de la VAR allait tout arranger, alors que c’est un sport où la majorité des décisions sont soumises à interprétation. Et il y aura toujours des avis contraires, notamment des personnes qui se sentent lésées. Concernant l’histoire de l’équipe de France, il y aura toujours des polémiques. La première qui me revient, c’est la main de Henry contre l’Irlande en barrages de Coupe du monde en 2009 ou le coup de tête de Zidane en finale en 2006. Ce qui nous réunit autour du football, c’est la passion, et l’arbitrage y participe.
« En finale de la Coupe du monde 2022, la VAR n’a pas été utilisée »
Ce qui me frappe, quand je travaille pour des articles sur des matchs de l’équipe de France, c’est que finalement, lors les différentes finales auxquelles elle a participé, alors que les supporters français se plaignent souvent de l’arbitrage, les décisions sont plutôt à l’avantage des Bleus…
Pour la finale de 2022, il y a une certaine cohérence dans les décisions de Szymon Marciniak entre la faute sifflée sur Di Maria pour les Argentins, celle sur Kolo Muani en fin de match… C’est ce qu’on demande aux arbitres : que le niveau de fautes sifflées soit le même pour les deux équipes, ce qui était le cas. Avec Michel Vautrot, on avait d’ailleurs remarqué que sur cette finale, on n’avait pas vu de VAR utilisée et il n’y a pas eu de contestation des décisions arbitrales. Sauf sur le fait que des joueurs argentins seraient entrés sur le terrain lors du but de Messi en prolongations, mais c’est tout.
Y a-t-il une contradiction fondamentale entre la volonté des instances d’uniformiser l’arbitrage, de le dépersonnaliser, et la nécessité accrue d’expliquer les décisions, de faire de la pédagogie auprès des joueurs mais aussi du public ?
On pourrait le penser, mais au final ça se rejoint quand même. Dans les années 1980-1990, on avait vraiment différents styles d’arbitrage. Maintenant, les instances uniformisent aussi la manière d’expliquer les décisions. Les arbitres français sont formés sur ce qu’il faut dire, comment le dire. La logique est qu’ils soient interchangeables, qu’ils fonctionnent de la même manière, va manager son match de la même manière. Avec l’arrivée de la VAR, on tend de plus en plus vers ça.
« Il faut une personne qui tranche, et ça doit être l’arbitre central »
La mise en place de la VAR en 2018, quasiment parallèle à la professionnalisation des arbitres d’élite en France, mais aussi la GLT, affaiblit-elle le rôle de l’arbitre au profit de celui d’autres arbitres, en déplaçant la subjectivité hors du terrain ?
Par rapport à la technologie, il y a des aspects où je trouve ça très positif, pour des cas binaires comme la Goal Line Technology qui permet de savoir si un ballon a franchi ou pas la ligne de but. Les enjeux symboliques et économiques sont tellement importants que des erreurs de ce type, comme pour le but fantôme de Lampard à la Coupe du monde 2010 (Allemagne-Angleterre), ne sont plus acceptables.
Concernant les fautes à interprétation, ça rend très confuses les décisions de l’arbitre, car il va être appelé par son assistant vidéo pour changer la décision alors qu’il était très bien placé. Ça nuit à la crédibilité de l’arbitre, à son autorité. On est très souvent dans une zone grise, notamment pour les fautes de main dans la surface. J’ai tendance à plus faire confiance à l’arbitre sur le terrain, qui sent le jeu, avec un certain contexte. On a eu un exemple récent lors de Saint-Etienne-Lyon, où l’arbitre avait mis un carton rouge, et où au final, une personne en dehors du contexte, qui va voir certaines images au ralenti, va avoir un autre ressenti, et va amener à faire changer la décision de l’arbitre. Il faut une personne qui tranche, et ça doit être l’arbitre central. Quand plusieurs personnes réfléchissent à des situations complexes, ça fait perdre du sens et de la crédibilité.
« Ça va prendre beaucoup d’années pour que l’arbitrage féminin se systématise »
Les deux éléments essentiels qui traversent le livre sont l’argent et la médiatisation. Pour le premier, comment expliquer l’énorme retard pris par la professionnalisation de l’arbitrage, plus de 80 ans après celle des joueurs, en France ?
Il y a retard très important, le changement majeur c’est la Coupe du monde 1990 avec Sepp Blatter, secrétaire général de la FIFA, qui disait que ce n’était plus possible d’avoir une telle différence de niveau entre joueurs et arbitres. La première fédération à s’engager dans la professionnalisation, c’est l’italienne, dès 1993. La FA en Angleterre a sauté le pas en 2001. Pourquoi on a pris autant de temps ? C’est la dimension médiatique des rencontres : la proximité des arbitres vis-à-vis du jeu, les conséquences économiques de plus en plus importantes pour les club. D’où la nécessité d’avoir des arbitres plus jeunes, préparés physiquement et psychologiquement pour diriger de telles rencontres.
Pour le deuxième, la retransmission télévisée a placé les téléspectateurs (et les commentateurs) en position d’arbitres eux-mêmes. Dans ce cadre, peut-on dire que la télévision, et surtout le ralenti, étaient les prémices de l’arbitrage vidéo ?
Des les années 1970, on commence à parler dans les médias d’arbitrage vidéo, en fait dès que le téléspectateur a la possibilité de revoir des images au ralenti sur son écran, et de vouloir ré arbitrer certains matchs. Ça va ne faire que s’amplifier au fur et à mesure des décennies jusqu’à aujourd’hui.
Ton travail retrace aussi l’arrivée des femmes dans l’arbitrage, et notamment d’élite. Le fait qu’elles commencent à arbitrer des matchs d’équipes masculines peut-il changer la vision de l’arbitrage ? A quand un match des Bleus arbitré par une femme ?
Il y a une volonté des instances, très récemment, de féminiser l’arbitrage, que ce soit la FIFA, l’UEFA ou la FFF. A l’échelle de la France, derrière Stéphanie Frappart, c’est l’arbre qui cache le désert. L’arbitrage des femmes est très peu développé. Ça va prendre beaucoup d’années pour que l’arbitrage féminin se systématise. On est encore au début d’un processus, il faut une masse d’arbitres féminines pour espérer avoir une élite performante.