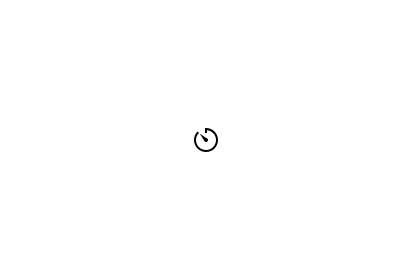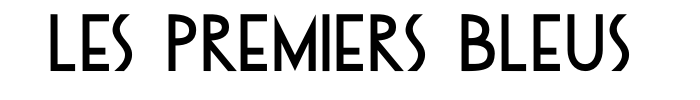12 minutes de lecture
Tout est parti d’une série de photos postées sur Twitter en mai 2018. Sur la dernière, la tranche rouge du Dico des Bleus est nettement visible. Six mois plus tard, le Dico est désormais rangé dans l’annexe bibliographique de la première thèse de doctorat consacrée aux Bleus. Et on n’est pas peu fiers.
#MontreTaBibli mais seulement le bureau. Schizophrénie d'un historien du football : un grand angle de livres d'histoire face à un pan de mur de livres sur le ballon rond. Même chose pour les autres champs hybrides ? pic.twitter.com/xoGdvKw10r
— DA ROCHA CARNEIRO (@FDaRochaC) 27 mai 2018
Il ne doit pas y avoir beaucoup de thèses d’histoire sur l’équipe de France de football… En quoi l’histoire du sport est riche d’enseignements sur l’histoire nationale ?
La thèse que j’achève [1] est la première portant sur l’histoire de l’équipe de France. Des historiens avaient déjà consacré des articles à des moments, des joueurs ou des thèmes, mais aucun travail universitaire n’avait porté sur la sélection dans son ensemble, depuis ses origines. L’objectif n’était pas de faire une histoire nationale par le football mais davantage d’opter pour une approche sociale et de comprendre comment des joueurs, les internationaux, participent à la construction d’une institution sportive.
« Il n’est pas envisageable de faire abstraction du contexte politique, économique ou culturel du moment »
Cependant, l’objet touche en effet à des secteurs qui dépassent largement la seule dimension sportive. Il n’est pas envisageable de faire abstraction du contexte politique, économique, culturel du moment. Pour prendre les exemples les plus évidents, l’absence de rencontres internationales entre juin 1914 et 1919 ou la rareté des matchs de l’équipe de France entre 1940 et 1945 s’expliquent évidemment par le contexte des deux guerres.
Parce qu’elle est au carrefour de ces thèmes, l’équipe de France porte en effet en elle une histoire nationale, même si la thèse relève bien de l’histoire du sport !
L’équipe de France d’avant-guerre, voire même d’avant 1958 est largement méconnue du grand public. Elle n’est pourtant pas sans intérêt, même si son niveau sportif était bas…
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette ignorance du grand public à l’égard de l’équipe de France d’antan. C’est entre autres lié à la manière dont se construit la mémoire, individuelle ou collective. Ainsi, l’intensité de l’émotion peut marquer autant que le fait qui la provoque. Le nombre de spectateurs assistant à un match est forcément contraint par la capacité d’accueil du stade et le nombre de rencontres internationales par saison n’atteint que rarement la dizaine jusque dans les années 1980, hors année de compétition.
Or, la retransmission télévisée en direct est non seulement tardive mais aussi incomplète. Jusque dans les années 1960, il arrive que la télévision ne retransmette qu’une mi-temps d’un match. Pour les périodes les plus reculées, le public manque donc de ces images animées vécues en direct et provoquant d’éventuelles émotions inoubliables.
Par ailleurs, le suspense participe de la mise en drame du spectacle sportif et c’est essentiel pour fixer des éléments de mémoire. Le visionnage en différé fait perdre beaucoup en la matière : quand on connaît la fin, les prolongations de Séville ou le France-Paraguay de 1998 perdent un peu de leur intérêt sensationnel.
Cependant, cette impression d’une mise à l’écart de l’équipe d’avant-guerre ou d’avant 1958 dans la mémoire collective est à relativiser. Ce qu’on retient des équipes, même les plus récentes, ce ne sont bien souvent que des figures saillantes. Beaucoup ont oublié les éphémères, ces joueurs qui ne font que passer en sélection et qui pourtant constituent la majorité de cette équipe.
« Henri Skiba, soldat allemand, prisonnier côté soviétique, naturalisé français et sélectionné en 1959-1961 »
De 1904 à aujourd’hui, plus d’un quart des internationaux n’ont qu’une sélection et plus de la moitié comptent cinq matchs ou moins sous le maillot de l’équipe de France. On parle souvent des années Platini, mais le grand public a bien souvent oublié les Carlos Curbelo, Didier Christophe ou Didier Sénac, pourtant internationaux à la même époque.
Même chez les champions du monde, ceux de 1998 comme probablement ceux de 2018, seuls quelques personnages impriment la mémoire. On a somme toute du mal à sortir du résumé de l’équipe à quelques stars. Je m’en tiens à trois exemples. Lors d’une intervention en colloque à Lyon, il y a quelques années, au moment des questions, un homme prend la parole et ne me demande rien : il me remercie juste d’avoir prononcé le nom d’André Chorda qui était son joueur préféré dans ses jeunes années.
Il y a quelques mois, Pierre Grillet décédait : il fallu un hommage familial, celui de sa nièce, la journaliste Lauren Bastide, dans une belle série de tweets pour que sa personnalité soit un peu mise en avant. Quant à la mort d’Henri Skiba, soldat allemand, prisonnier du côté soviétique, naturalisé français et sélectionné à trois reprises en 1959-1961, elle est passée tellement inaperçue que la FFF l’a annoncée sur son site trois semaines après les journaux régionaux, sans même relayer l’information sur son compte Twitter.
« Le gardien de but ou les attaquants participent davantage à la mise en spectacle que d’autres »
De fait, plus qu’une mémoire collective qui ne retiendrait l’équipe de France que pour une période récente, j’aurais tendance à imaginer des cercles de postérité concentriques pour lesquels il faudrait prendre en compte la durée de la carrière internationale, le nombre de sélections, l’exposition médiatique, l’ancienneté bien sûr aussi, mais également peut-être le poste occupé sur le terrain.
En effet, certains postes, comme le gardien de but ou les attaquants, participent davantage à la mise en spectacle du football que d’autres. On aurait alors au sein d’un premier cercle le nom des rares joueurs que tous, même ceux qui se désintéressent du football, seraient capables de citer et, progressivement, on atteindrait un dernier cercle contenant ceux que seuls les plus initiés seraient en mesure de nommer.
Vous avez écrit, pour la revue Historiens et Géographes, un article sur les joueurs de l’équipe de France pendant la Première Guerre mondiale. Ils sont nombreux à y avoir participé. Tous n’en sont pas revenus… Leur milieu social modeste les exposait-il plus au combat ?
C’est une erreur fréquente que d’associer systématiquement élite du football et milieu populaire, du moins pour cette période. Julien Sorez a par exemple bien montré l’importance des « classes moyennes », des employés en particulier, dans le football parisien. De fait, les internationaux morts pour la France ne sont pas tous issus des catégories les moins favorisées. Je retiendrais le contre-exemple d’André Puget, qui descend d’une lignée de la haute-magistrature, mort en mai 1915 à Neuville-Saint-Vaast.
« Emile Sartorius, blessé à l’été et amputé d’un pied, décède en 1933 »
Si le football est déjà démocratisé avant le déclenchement du conflit, les couches les plus aisées sont encore très présentes dans le paysage sportif d’alors. Il y a par exemple beaucoup de fils de la bourgeoisie textile du Nord qui portent le maillot de l’équipe de France et qui participent aux combats. Ainsi, lors des Jeux Olympiques de Londres, en octobre 1908, l’équipe de France subit la pire défaite de son histoire, sur le score de 17-1 contre le Danemark.
Le buteur français est un Roubaisien, Emile Sartorius, dont le père, allemand, s’est installé dans la Manchester du Nord peu avant la naissance du futur international. Ce footballeur, qui appartient à l’élite économique locale, est blessé pendant l’été 1918 et doit être amputé du pied. Il meurt en 1933, bien après la fin de la guerre donc, mais est reconnu « mort pour la France » en 1946.
L’histoire des Bleus est aussi une histoire de l’effacement progressif des distances. Au début du 20e siècle, un voyage à Rotterdam ou à Budapest est déjà une épopée. La Coupe du monde en Uruguay en 1930 marque-t-elle une étape importante dans l’ouverture au monde des Bleus ?
Le football doit en effet beaucoup à la révolution des transports. Mais la Coupe du monde 1930 est elle-même à la croisée de plusieurs étapes d’ouverture. C’est d’abord la tournée d’équipes sud-américaines, venues d’Uruguay, d’Argentine et du Brésil au milieu des années 1920, qui donnent à voir aux spectateurs et aux sportifs français d’autres joueurs, d’autres styles de jeu et même d’autres couleurs de peau, avec l’Uruguayen Andrade ou le Brésilien Friedenreich.
A cet égard, la victoire de la Celeste dans le tournoi olympique de Paris en 1924 marque un premier tournant marquant. En revanche, la Coupe du monde en Uruguay six ans plus tard ne semble pas, du moins immédiatement, ouvrir l’équipe de France au monde, ou plus exactement, elle n’ouvre que l’équipe de France et non le football français dans son ensemble. Les Français sont en effet parmi les rares Européens à participer à l’aventure sud-américaine et les récits qui parviennent en France sont ceux de joueurs de l’équipe de France, Augustin Chantrel et Maurice Pinel, et non de journalistes.

C’est donc une aventure collective, celle d’un groupe de sportifs qui découvrent l’ambiance survoltée des stades monumentaux et des foules passionnées, et non pas celle de toute la sphère du football français qui vivrait au rythme des exploits de son équipe.
Si la Coupe du monde en Uruguay ouvre sans nul doute l’horizon sportif de l’équipe de France, il faut aussi prendre en compte la mise en place du championnat professionnel en 1932 qui pousse les clubs à recruter quelques-uns de leurs joueurs à l’étranger, non seulement dans les pays frontaliers, ce qu’ils faisaient bien souvent déjà avant la reconnaissance du professionnalisme, mais aussi en Europe centrale où ils trouvent une main d’oeuvre meilleur marché et réputée performante (on est à l’époque de la Wunderteam autrichienne) et en Amérique Latine.
Les oriundi, ces descendants d’Européens installés dans le continent sud-américain, représentent ainsi un réservoir où puisent régulièrement les clubs français. Certains sont d’ailleurs sélectionnés en équipe de France avant la Seconde guerre mondiale, comme Hector Cazenave ou Pierre Duhart.
Quand on étudie l’origine des internationaux français depuis 1904, on est frappé de voir à quel point elle épouse les vagues migratoires du siècle passé, et comment l’assimilation se faisait en francisant les patronymes. Les choses ont bien changé, de ce côté. Le football est-il un accélérateur d’intégration ?
Là encore, les apparences peuvent être trompeuses. Les historiens qui ont écrit des articles sur l’équipe de France ont souvent abordé la question de l’immigration, parfois celle de l’intégration, ce qui ne veut pas dire que l’équipe de France soit une machine à intégrer, ni même d’ailleurs un miroir d’une société permettant cette intégration. Ce serait considérer la sélection comme forcément représentative, ce qu’elle n’est pas. La question se pose d’ailleurs géographiquement, dans les premières années de l’équipe de France, alors que les joueurs sélectionnés sont quasiment tous de Paris ou du Nord.
Ces précautions avancées, il est vrai que de nombreux joueurs de l’équipe de France sont immigrés ou issus de l’immigration et que leur présence à un moment donné correspond à une phase de l’histoire de l’immigration. Pour autant, dans les années 1930, Yvan Beck, yougoslave, Joseph Kaucsar, roumain ou Gusti Jordan, autrichien, ne sont pas issus de communautés très nombreuses mais au contraire font figure d’immigrés pour le football, bien plus que d’immigrés jouant au football. Quant aux oriundis, ils disent plus de l’émigration européenne avant la Première guerre mondiale que de l’immigration en France dans les années 1930.
L’équipe de France des années 1950, avec ses Piantoni et ses Kopa, fait figure de témoin d’une intégration réussie. C’est oublier surtout qu’il s’agit d’enfants d’ouvriers qui trouvent dans leurs compétences sportives le moyen de sortir de la condition à laquelle ils sont voués initialement. L’intégration, si intégration il y a, n’est nullement d’ordre national mais d’ordre social ! De la même façon, les joueurs composant l’équipe de France dans les décennies qui suivent ne sont pas, contrairement à ce qui pouvait se passer au début du siècle, des enfants des catégories les plus élevées de l’échelle sociale.
L’intégration de ces enfants d’immigrés me semble dont très biaisée par le facteur social qui prévaut à mon sens. Peut-être faudrait-il voir dans l’équipe de France non pas le témoignage que des enfants d’étrangers peuvent désormais représenter la France, mais davantage l’ambition possible d’enfants parmi les moins favorisés de France.
Et encore, nous sommes là dans une description très caricaturale qui ne prend pas en compte la diversité des origines sociales au sein de l’équipe (les classes moyennes sont encore souvent représentées, jusqu’à aujourd’hui), ni surtout les tensions qui traversent le pays : la France de Kopa, c’est aussi celle des exactions pendant la guerre d’Algérie ; la France de Platini, c’est aussi celle des élections de Dreux et de la montée du FN ; la France de Zidane, c’est aussi celle de Jean-Marie Le Pen au second tour ; la France de Pogba, c’est aussi celle de Marine Le Pen également au second tour.
N’oublions pas trop vite les doutes et errements de notre société en présentant l’équipe de France comme un modèle national qui dirait la qualité d’une intégration supposée !
La guerre d’Algérie a aussi marqué l’équipe de France, avec le départ clandestin de plusieurs internationaux quelques semaines avant la Coupe du monde 1958, dont Rachid Mekhloufi. Il faudra attendre vingt ans de plus pour voir l’équipe de France jouer contre une ancienne colonie, à savoir la Tunisie en 1978. On est encore loin d’un Algérie-France en Algérie…
L’équipe du FLN s’est en effet construite avec la participation active de joueurs de l’équipe de France, parmi lesquels Rachid Mekhloufi et surtout Mustapha Zitouni, qui se prive alors d’une participation presque certaine à la Coupe du monde en Suède.
C’est vrai qu’il existe parfois une dimension politique parallèlement à l’enjeu sportif. Un match Algérie-France aurait sans nul doute un parfum particulier, mais il est peu probable qu’il se déroule avant que d’autres étapes aient été franchies dans les relations entre les deux pays. Il s’agit là d’un cas très particulier qu’on ne peut comparer à ceux des autres colonies, en particulier des équipes représentatives des pays issus de l’AOF et de l’AEF.
« Des logiques sportives et techniques davantage que politiques pour expliquer l’absence de déplacement en Afrique Noire »
Si l’équipe de France a jusqu’alors évité les déplacements en Afrique Noire, cela s’explique davantage sportivement et techniquement que politiquement. La majeure partie de ses adversaires sont en effet des membres de l’UEFA, dans les matchs amicaux mais aussi, bien sûr, dans les compétitions continentales et dans les éliminatoires pour la Coupe du monde.
Dès lors qu’elle entend tenir une place de premier plan dans le concert des nations du football, l’équipe de France a aussi intérêt à se trouver des adversaires aux caractéristiques de jeu comparables à ceux que le sort lui attribue en compétition internationale, et ça ne tombe pas si souvent sur une équipe africaine.
Enfin, pour la sécurité de la délégation, les matchs à l’extérieur sont en général organisés dans des lieux suffisamment sûrs et confortables, y compris pour la pratique du jeu. C’est sans doute regrettable, même pour le spectacle, mais on imagine mal l’équipe de France évoluer sur un terrain trop défectueux, au risque que certains de ses joueurs se blessent et que certains commentateurs hurlent au scandale. Ce sont les mêmes logiques, sportives et techniques, davantage que politiques, qui expliquent que la sélection française n’ait jamais rencontré la Moldavie, l’Indonésie ou le Guatemala.
Comment interprétez-vous le retour de balancier de la décolonisation, avec des joueurs d’origine africaine nés en France qui optent pour le pays d’origine de leurs parents ou grands parents après avoir joué pour les sélections de jeunes en équipe de France ?
La question dépasse largement le cadre des anciennes colonies. A part de très rares exemples où le choix est dicté par le coeur, et c’est tout à fait respectable, dans la plupart des cas, les joueurs sélectionnés avec la France dans les équipes de jeunes trouvent dans le pays d’où sont originaires leurs parents ou leurs grands-parents, la garantie d’une carrière internationale.
« Perquis et Obraniak optent pour la nationalité sportive polonaise et peuvent s’installer dans une carrière internationale »
La concurrence est telle que, pour la plupart, l’accession à l’équipe de France et surtout la pérennité de la carrière dans cette sélection sont très incertaines. Ils optent donc pour des sélections auxquelles ils peuvent prétendre et dans laquelle ils ont plus de chances de s’installer. On peut prendre l’exemple de Damien Perquis et de Ludovic Obraniak, tous les deux internationaux Espoirs français, qui optent pour la nationalité sportive polonaise et peuvent ainsi s’installer dans une carrière internationale, participer même au Championnat d’Europe en 2012, alors que l’équipe de France ne leur paraissait pas spécialement accessible.
On tend à se focaliser sur les joueurs d’origine africaine, d’Afrique Noire ou d’Afrique du Nord, mais cela témoigne surtout de la difficulté qu’a notre société à envisager des relations apaisées avec nos anciennes colonies. On a vite fait de soupçonner nos compatriotes dont les familles sont originaires de l’ancien Empire colonial de ne pas être assez Français, alors qu’il ne s’agit là que de choix sportifs ayant bien peu de conséquences sur l’équipe de France, sauf à la priver d’un réservoir de main d’oeuvre dans laquelle elle ne puiserait de toute façon guère.
1998 marque-t-il un seuil à partir duquel l’équipe de France est devenue autre chose qu’une sélection ?
Comme l’écrit Stéphane Beaud, il s’est passé quelque chose en 1998, c’est indéniable. Je ne suis pas certain qu’il faille cependant voir dans l’équipe de France de football autre chose que ... l’équipe de France de football, dans ses moments les plus glorieux comme dans ses passages à vide. Ce qui s’est passé autour de la victoire relève de la réaction d’une société, non de la sélection elle-même. Les joueurs disent d’ailleurs assez leur surprise de voir l’engouement qui saisit les foules lorsque leur bus sort de Clairefontaine ou y revient.
Sur un plan uniquement sportif, 1998 marque la première victoire dans le tournoi mondial, mais n’est que cela. Ce n’est même pas le premier titre obtenu par l’équipe de France, dans une compétition organisée chez elle, puisqu’elle gagne le championnat d’Europe en 1984. C’est néanmoins le premier titre mondial. C’est surtout le fruit d’une histoire du football français, de la politique de formation mise en place dans les années 1960-1970, d’un prestige regagné sous les années Platini, de l’ouverture au marché européen, bien plus qu’un commencement d’un nouveau cycle sportif.
« En 1998, la société a pu laisser croire qu’elle faisait enfin République »
Si on se place non plus du côté du terrain, mais dans la foule, il est évident qu’il y a là un tournant, avec l’impression, peut-être illusoire, d’un bonheur partagé, d’une communion nationale possible, dépassant les habituelles césures de milieux sociaux, de genres, d’ethnies,... La société, au prétexte d’une victoire sportive, a pu laisser croire qu’elle faisait enfin République.
L’usage du titre mondial n’est d’ailleurs pas que social. Il faut aussi souligner l’importance de la récupération politique. Si quelques brèches étaient apparues dans les décennies précédentes (Michel Hidalgo aurait été ainsi approché pour entrer dans le gouvernement Fabius en 1984), le mur séparant le politique et le football se fissure largement dans les années 1990, d’abord avec les propos de Jean-Marie Le Pen sur La Marseillaise, puis avec l’opération récupération de Jacques Chirac lors de la Coupe du monde.
Le président de la République était ignorant du football, au point que Philippe Séguin prétendait qu’il ne comprenait même pas pourquoi les deux équipes ne jouaient pas avec le même maillot. Il avait néanmoins besoin de redorer son blason, alors qu’il était en cohabitation à la suite des élections législatives perdues en 1997. Il a saisi l’occasion, s’est présenté comme le premier supporter de l’équipe, a su occuper l’espace médiatique et a tiré sans doute profit de la victoire finale.
Mettons de côté pour terminer votre métier d’historien, et venons-en à ce que vous avez en commun avec ceux qui nous lisent : votre amour du football. Quel est votre premier souvenir de l’équipe de France, et quelle place cette dernière occupe-t-elle dans votre histoire personnelle ?
Je pense que mes premiers souvenirs remontent à la fin des années 1970. J’avais huit ans lors de la Coupe du monde en Argentine, je jouais un peu au foot dans la cour de récréation (un peu, donc à chaque récré), j’allais commencer à pratiquer en club. La pratique du jeu et l’attention portée aux matchs de l’équipe de France sont donc simultanées.
« Mes premiers souvenirs des Bleus, c’est l’Argentine en 1978, la blessure de Bertrand-Demanes... »
Il est vrai que les matchs diffusés à la télévision étaient alors assez rares et il s’agissait surtout de ceux de l’équipe de France. Mes premiers souvenirs sont donc sans doute liés à la Coupe du monde en Argentine. Je n’avais bien sûr pas conscience des enjeux politiques du moment. Ce sont des vignettes Panini, c’est la blessure impressionnante de Jean-Paul Bertrand-Demanes contre l’Argentine, c’est l’injustice ressenti face à un pénalty inscrit à la 46e minute, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps...
Le football m’intéresse et mes proches se disent que c’est un moyen pour m’inciter à lire. Je me souviens d’un livre qu’on m’avait alors offert sur les meilleurs gardiens de but de l’histoire. C’est là que j’ai entendu parler pour la première fois de Chayriguès, Hiden et Vignal ! Des souvenirs somme toute diffus qui se précisent peu à peu, à mesure qu’on avance dans le temps. J’ai été marqué, alors que j’avais dix ans, par la mort d’Omar Sahnoun, et bien sûr, surtout, deux ans plus tard, par l’épopée en Espagne. La demi-finale de Séville reste sans nul doute le premier souvenir complet et clair !