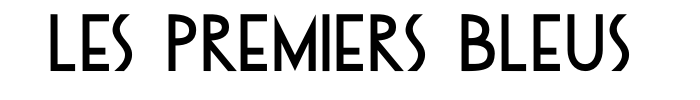Qu’est-ce qu’un livre d’histoire, au fond, sinon quelque chose qui nous raconte de petites histoires, à taille humaine et au niveau du sol, j’allais dire du gazon, pour mieux nous parler de la grande histoire, celle qui fait basculer des continents et des générations ? Cramponné au terrain, aussi bien réel que métaphorique, François da Rocha Carneiro ne s’interdit pas pour autant de longues transversales à travers le temps et l’espace, des coups d’épaule bien sentis contre les idées reçues, voire de délicieuses roulettes stylistiques uniquement pour le plaisir du jeu. C’est tout l’intérêt de Une histoire de France en crampons, publié le 25 août par les éditions du Détour.
-
Lire l’interview François da Rocha Carneiro : « Retrouver un match de la Belle Epoque, c’est une façon de sortir du présentisme »
« Il a fallu ensuite jouer de ces va-et-vient si familiers aux historiennes et historiens, de son objet à son contexte, de son contexte à son objet ; quitter parfois le ballon des yeux pour regarder le monde vibrer autour de lui ; oublier les affres du temps pour suivre le match jusqu’à ses dernières secondes. » Et surtout ne jamais oublier de faire le lien entre les deux.
Le livre, qui raconte « une histoire de France, pas l’histoire de la France », précise l’auteur, est construit en quatre temps, non pas chronologiques (trop facile) mais thématiques, à partir de quatre types de joueurs qui sont autant de catégories de citoyens (d’ailleurs superposables et non exclusives) : le soldat, le fils d’étranger, le travailleur et le démocrate.

Un luxe de détails quasi-cinématographique
Pour autant, ce n’est pas une galerie de portraits que nous dresse François da Rocha Carneiro, mais vingt récits de matchs. Poursuivant le travail fondateur de sa thèse d’histoire sur l’équipe de France, soutenue en 2019 et qui avait généré un premier livre [1], l’auteur prend le parti de décrire, avec un luxe de détails quasi-cinématographique, des rencontres jouées par l’équipe de France de 1908 à 2015. Pas les plus importantes, non : l’idée n’est pas de retracer les grands moments des Bleus, mais de s’appuyer sur des matchs dont le contexte historique, le moment et le lieu font sens.
Par exemple, plutôt que l’épopée suédoise de 1958, le dernier match amical avant celle-ci, un 0-0 sans relief contre la Suisse (un paradoxe géographique, pour le coup) mais qui voit les Bleus privés de quelques joueurs ayant rallié l’équipe du FLN. Pas le RFA-France mythique de Séville en 1982, mais celui d’avant face à l’Irlande du Nord qui voit la naissance d’un carré magique composé de quatre descendants d’Italiens, d’Espagnols et de Maliens. Plutôt que le France-Italie de 1938 en Coupe du monde à Colombes, le Italie-France de décembre suivant à Naples. Et à la place de l’inaugural Belgique-France de 1904, un de ses successeurs quatre ans plus tard, en 1908.
Nous voici ainsi propulsés au bord de ce qui servait alors de pelouse (et qui avait plus de points communs avec un terrain vague, bosselé et pelé, qu’avec les golfs actuels), comme ce 9 mars 1919, premier match d’après-guerre : « L’équipe de France pénètre d’abord sur un terrain rendu gras par une pluie continue. La Marseillaise accompagne des joueurs revêtus de chaussettes rouges, d’un short blanc et du maillot tricolore à rayures du CFI.Le capitaine belge, Georges Hebdin, gagnant le toss contre son homologue français, Gabriel Hanot, il laisse aux visiteurs le soin d’engager le jeu, préférant choisir la partie de terrain que le sens du vent rend la plus favorable. » Ça, c’est pour l’immersion. « Ce Belgique-France du 9 mars 1919 propose donc une transition complexe d’un football de guerre à un football de paix, dans un temps dilaté entre l’armistice et la démobilisation ». Ça, c’est pour le travelling arrière, qui replace un match quelconque dans un contexte qui ne l’est pas du tout.
Dans le Berlin pavoisé de croix gammées, en mars 1933
La quintessence de choix stylistique, on la trouve dans le récit d’un étouffant Allemagne-France, le premier de l’histoire joué outre-Rhin, à une date qui n’est évidemment pas neutre : le 19 mars 1933. « Les récits touristiques que font les journalistes sont placés sous le sceau de la surprise : dans cette Allemagne qu’on disait à feu et à sang, c’est à peine s’ils perçoivent la dictature qui s’abat. La plupart s’en tiennent à un regard presque amusé sur ces nazis, parfois très jeunes, qui quêtent en chaque rue, en chaque hôtel, en chaque restaurant, pour nourrir les caisses du parti, faisant résonner un bruit incessant dans la ville. » On est littéralement là, dans ce Berlin pavoisé de bannières à croix gammée, de la gare de Friedrichstrasse jusqu’au stade de Grunewald où se pressent 60.000 spectateurs parmi lesquels Heinrich Himmler et Jean Gabin. « À 3-1, le sort de la partie est scellé et quelques supporters allemands le disent déjà volontiers : Sieg ist fest (La victoire est certaine.) » Le chapitre s’intitule Face au monstre.
Cette histoire de France en crampons est aussi l’occasion de rappeler qu’elle est faite d’au moins autant de constantes que de variables : François da Rocha Carneiro raconte ainsi l’apport essentiel des joueurs nés à l’étranger, en écho à l’immigration économique qui a reconstruit le pays, mais aussi l’accueil qui leur fut fait, comme en 1954 pour les Polonais et les Italiens alors majoritaires en sélection : « La presse de l’époque va parfois jusqu’à laisser entendre que la sélection est devenue le réceptacle de tout ce dont les pays d’émigration avaient de pire. La même année, un journal irlandais n’hésite pas à dénoncer le cosmopolitisme à l’œuvre dans la sélection française, qui ne serait qu’« une formation de naturalisés et d’étrangers » ; raison pour laquelle il conviendrait de siffler ces joueurs qui « ne sont pas les vrais footballeurs de la France ». »
Ce bateau pour l’Algérie qui avait du retard, en octobre 1962
S’il revient sur l’épisode de l’équipe du FLN, qui a brisé la carrière internationale de Rachid Mekhloufi et de Mustapha Zitouni, il raconte aussi les contingences plus banales qui peuvent avoir de grandes conséquences, comme les circonstances qui ont fait que Smaïl Zidane n’est pas retourné en Algérie : le futur père de Zizou, qui a participé à la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris qui a fait plusieurs centaines de morts, décide de rentrer à Algérie un an plus tard. Il s’arrête à Marseille en octobre 1962 mais comme le bateau a trois jours de retard, il s’installe chez un cousin et tombe amoureux de Malika, sa future femme. « Ainsi, Zinedine Zidane est-il un enfant de la Castellane. Pour lui, la question du retour se pose d’autant moins qu’il n’y a pas eu d’aller », conclut-il joliment.
En écho à l’Allemagne-France de mars 1933, on retrouve celui de novembre 2015. Le soir du 13. Pour faire revivre cette soirée épouvantable où les attentats ont frappé la région parisienne, l’historien choisit de décrire en contrepoint des trois explosions autour du Stade de France la banalité de ce qui se passe sur la pelouse, les échanges de passe entre Evra, Pogba, Koscielny, Marial, Matuidi ou Varane. Puis, en deuxième période, des infos inquiétantes commencent à circuler.
« Des spectateurs au Stade de France, des journalistes aussi, apprennent qu’il se passe quelque chose dans Paris, mais l’enceinte persiste à vibrer alors comme si elle était isolée du monde ; ce qu’elle est de fait, par la fermeture des grilles décidée par le préfet de Seine-Saint- Denis. » C’est le grand télescopage entre la petite histoire de l’équipe de France et la grande histoire du terrorisme international, avec les exemples de la soeur d’Antoine Griezmann, au Bataclan et saine et sauve, et la cousine de Lassana Diarra, tuée lors d’une fusillade des terrasses. « Le milieu de terrain incarne dès lors autant la douleur des familles des 130 victimes, parmi d’autres proches, que la porosité entre la société meurtrie et l’équipe de France. Cible des explosions du Stade de France, celle-ci devient porteuse du deuil privé, en la personne de Lassana Diarra, en même temps que de l’intimation à la résilience collective, par le maintien du déplacement à Wembley. »
Ce nouveau virus qui circule, en janvier 2020
Le livre s’achève par deux matchs qui n’ont pas eu lieu, dans ce temps suspendu du premier confinement, au moment où la pandémie de Covid-19 se propage comme un feu de brousse. Le récit glaçant des premières semaines de 2020 où la vie quotidienne se déroule encore normalement alors que le virus est sorti de la Chine et circule en Europe est l’occasion d’un ultime télescopage entre la petite et la grande histoire : « Le lendemain de l’opération de Moussa Sissoko, l’Organisation mondiale de la santé suppose officiellement que les nombreuses pneumonies qui touchent depuis la mi-décembre la province chinoise du Hubei pourraient trouver son origine dans un nouveau coronavirus. »
Cet épisode-là, dont il n’est pas sûr du tout qu’on en soit sorti, conclut un travail remarquable qui n’oublie pas l’humilité : « Dans une telle adoption des préceptes du football par la communauté historienne, il sera bon de se souvenir d’un principe élémentaire d’où découlent toutes les astuces du jeu : aussi rapide qu’il soit, le joueur va toujours moins vite que le ballon. » On ne saurait mieux dire.